
France culture, poésie et ainsi de suite : « Lune Vuillemin : quelque chose de la forêt »
Pour écouter Lune Vuillemin au micro du podcast : Poésie et ainsi de suite, avec Manou Farine :

Pour écouter Lune Vuillemin au micro du podcast : Poésie et ainsi de suite, avec Manou Farine :
Fuyant les plaines où elle vient de perdre Franck, un brasseur de houblon qu’elle aimait comme un père, une femme fait du stop aux abords d’une forêt. Le garde-forestier la prend en charge mais doit changer de cap pour se rendre sur le sauvetage d’un animal en danger. Une orignale s’est fait prendre au piège dans les eaux gelées du lac Petit. Là, la narratrice est subjuguée par le travail d’Arden, une femme aux mains étranges et de Jeff, un homme à l’oeil de verre.
Sans réelle destination, elle accepte de les suivre dans leur refuge pour animaux sauvages blessés. Arden propose de la loger contre quelques heures au service des animaux malades.
La narratrice aime cette vie au plus près de la nature. Elle écoute les conseils d’Arden, aime suivre Jeff dans la forêt. Ce sont des lieux reposants où il faut savoir écouter le silence, respecter la vie animale. Lune Vuillemin décrit cette nature sauvage avec beaucoup de poésie en faisant appel à tous nos sens.
Je ne peux pas croire que ce qui se joue dans la nature n’est que survie, reproduction, naissance, prédation et mort. Il y a autre chose, j’en suis persuadée. La forêt regorge d’histoires et elles ne sont pas les nôtres. Que dit un arbre envahi par le parasite ? Existe-t-il un pleur, une lamentation ou une résignation en langue végétale que nous ne saurions discerner ? De temps en temps j’entends mon cœur ou alors je sens l’appel d’une articulation et le désir gonflant de la faire craquer. Je ne parviens pas à me détacher de mon corps, il est là, sa présence fait partie de la forêt et de ses bruits. Je repense à tout ce qui ne se joue pas quand je suis là. »
La rivière Babine est un personnage à part entière, tout comme le sapin baumier, la lumière ambrée. C’est un lieu habité d’esprits, de faune, de flore, de lumière, de bruits et de silence. Dans cette forêt et ce refuge, animaux blessés et humains peuvent se reconstruire loin de la violence des hommes. La narratrice et Arden se retrouvent autour de leur passé traumatique. Ensemble, dans ce lieu apaisant et protégé, elles peuvent panser leurs plaies respectives.
Mais les tentatives pour sauver la nature et les âmes semblent parfois vaines.
Je pense parfois à l’orignale et à ce cordon entre nous, à mes tentatives vaines de lui insuffler ce qu’il lui faut pour reprendre des forces. Jeff dit qu’Arden ne se remet jamais de leurs échecs. On ne s’habitue jamais à échouer. Moi je crois qu’on ne s’habitue tout simplement pas à la mort.
Un très beau récit qui nous rappelle avec beauté l’importance de la nature pour la sérénité de nos vies et le nécessaire besoin de la protéger.
« La glace soliloque sous le ciel blanc, parfois elle grince des dents, se met à rire et sa mâchoire claque. Sa peau blanche gercée de bleu semble forte et prête à recevoir les baisers ardents du printemps. Il y a d’abord une expiration de brume sur les sapins baumiers, puis le froid bondit d’un bout à l’autre du lac à la manière des chevreuils en fuite. »
C’était il y a quatre ans, autant dire une éternité … Aire(s) Libre(s) voyait le jour et tombait sous le charme de Quelque chose de la poussière, premier roman d’une jeune autrice que l’on se promit alors de suivre avec attention. Quatre ans, donc, une nouvelle maison d’édition, et un des plus beaux titres de cette rentrée d’hiver. Border la Bête.
Quelque part au bord d’un lac, dans les forêts de Colombie-Britannique, la narratrice assiste à la tentative de sauvetage d’une orignale. Profondément touchée et intriguée par les deux personnalités qu’elle rencontre ce jour-là, éprouvant elle-même le besoin de faire une pause dans sa vie afin d’évacuer l’angoisse qui l’étouffe, la jeune femme décide de suivre Arden et Jeff jusqu’au refuge animalier dont ils s’occupent.
On retrouve ici ce qui nous avait saisis dès Quelque chose de la poussière, cet univers sauvage navigant en permanence entre ombre et lumière, au fond de ces forêts canadiennes où vécut l’autrice et qui lui tiennent tant à coeur. L’immersion est immédiate et totale, pour le lecteur comme pour cette jeune femme dont on ne connaîtra pas le nom mais dont on suivra la tentative de reconstruction après un drame esquissé au fil du récit. Les protagonistes de Border la Bête ne sont pas de grands bavards, ici les non-dits comptent autant que les mots et le silence occupe une place essentielle dans leur quotidien.
Si les humains sont mutiques, la nature, elle, ne l’est pas et c’est là une des grandes forces de ce roman que de parvenir à restituer l’ambiance unique qui règne dans ces immensités boisées. Inspirée et touchée par les marches silencieuses qu’elle fait en forêt avec son compagnon (et auxquelles il est fait allusion dans les remerciements), Lune Vuillemin excelle dans l’évocation des mille et un petits bruits qui peuplent littéralement les bois. Cette attention de chaque instant est au coeur même du récit et sera partie intégrante du processus de reconstruction entamé par la narratrice. Lors de l’entretien que nous avions eu avec elle à l’occasion de la parution de son premier roman, Lune nous confiait aimer l’absence de sons humains dans la nature et son attachement au mot wilderness, la nature dans son côté le plus sauvage. Paradoxalement inquiétante et rassurante à la fois, en fonction de l’état d’esprit dans lequel on l’aborde, cette nature omniprésente laisse ici peu de place à l’humain, il doit s’y plier, y créer l’espace qui lui permettra de vivre au plus près de la vie sauvage et d’apprendre à la connaître et à la respecter.
Border la Bête peut être lu comme un roman sonore, la bande son des forêts canadiennes mais c’est aussi et surtout un roman éminemment sensuel, organique. Si l’ouïe est très sollicitée, les autres sens le sont autant, qu’il s’agisse du goût, de l’odorat, de la vue ou du toucher. L’expérience est entière et ne peut se vivre à moitié. Il n’ y a ici pas de place pour le sentimentalisme mais les sentiments, eux, même s’ils peinent à s’exprimer, donnent toute son épaisseur au quotidien. La forêt n’est pas un lieu pour les tièdes, chacun(e) a ses fêlures et apprend à vivre avec ou tente de les comprendre pour mieux les apprivoiser.
Âpre et parfois rude, Border la Bête n’en est pas moins touchant dans ses descriptions de personnages à la fois forts et fragiles, qui confrontent leurs blessures intimes à l’indifférence de la nature et pansent leurs plaies du mieux qu’ils le peuvent. Il faut rester attentif à la beauté du sauvage semble nous dire Lune Vuillemin et l’on ne peut que la suivre dans ce sens, impressionnés par la maturité de son écriture et la même assurance qui avait marqué Quelque chose de la poussière.
« Tout me rappelle combien le sol sous nos pieds est fragile. Il n’y a pas que les orignaux qui meurent au matin. »
Yann.
Border la bête ou s’enfouir en forêt boréale, Border la bête et se laisser aller à une plume ensauvagée, Border la bête et faire partie d’un petit élément tangible au sein d’une vaste nature fragile.
Luce Vuillemin nous trace un chemin fait de découvertes, d’ornières, de passage à gué, d’animaux blessés, d’arrogance, de deuil, de forces en présence, de sensualité.
Quand tu la lis, tu as l’impression d’être immergé-e dans un espace où l’humain est modelé par la forêt. Pour une fois que l’inverse se tait.
Le roman commence par une chute, celle d’une orignale dans l’eau glacée d’un lac. Un homme et une femme vont tenter de la secourir, tout comme ils vont secourir, d’une certaine manière, celle qui nous raconte cette histoire.
Arden et Jeff soignent les animaux blessés, font leur part, évoluent dans un territoire pour y célébrer chaque interstice de vie forestière, en adéquation totale avec celles et ceux qui y vivent : le sapin baumier, la rivière, les coyotes, les poissons, les mésanges, le mélèze géant, les dindons sauvages, cette richesse qui n’est pas infinie, ce monde là dont Lune Vuillemin nous donne à ressentir les palpitations, êtres à part entière.
« Dehors, il pleut. Pour la première fois depuis que je suis ici. Je sors sur le chemin recouvert d’une couche de glace qui craquelle dans cette chaleur liquide de courte durée. Je reste un moment sous un sapin baumier qui se dresse à côté de la grange. Je suis assez petite pour trouver refuge sous ses bras. La pluie me fait un bien fou, les gouttes qui glissent sans éclater dans les aiguilles de l’arbre me tombent sur le front et les joues. Je n’aurais jamais cru recevoir une telle tendresse de la part d’un arbre et de la pluie. (…) «
La nature est source du vivant et l’humain s’y inscrit de manière passagère, Border la bête c’est prendre soin d’un Grand Tout et calmer la colère, la temporalité y est différente, plus lente et résiliente.
Fanny.
Voici un roman mordant, poétique, enivrant![]()
Alors que l’édition 2024 du Printemps des poètes a commencé, Reporterre revient sur le lien intime entre poésie et défense du vivant. Découvrez ces auteurs qui prennent à bras-le-corps la question écologique.
La poésie a toujours été présente dans le bouillonnement des pensées de l’écologie. Mais à l’aune de la catastrophe, on la redécouvre avec toute sa vitalité. Depuis quelques années, une révolution silencieuse agite les milieux écologique et littéraire, et les amène à se rencontrer. C’est un bruissement léger qui bouscule le langage et notre rapport au monde. Et si une poésie de la résistance écologique était en train de naître ?
Loin des discours technocratiques sur le « développement durable » et des mots usés et galvaudés sur la « transition verte », des poètes et poétesses décident de prendre à bras le corps la question écologique, de manière subversive et radicale. La littérature n’est pas une bulle fermée sur le dehors, un espace clos et hermétique, clament-ils. Au contraire, le poète se doit d’être « voyant, c’est-à-dire lumière qui s’allume pour nous alerter », écrit le philosophe Michel Deguy, dans La Fin dans le monde (éd. Hermann, 2009). La crise climatique est « un horizon indépassable », plaide aussi l’écrivain Jean-Luc Pinson. Dans ce contexte, le poète a un rôle à jouer, aussi infime soit-il. « On écrit de la poésie pour vivre. Pour faire, s’il se peut, que l’existence et le monde soient davantage habitables », dit-il.
Dans le Landerneau littéraire et écolo, l’agitation est réelle. Des collections de poésie se créent chez les éditions Wildproject ou Cambourakis. Elles en rejoignent d’autres, déjà installées, comme celle de Biophilia chez Corti. Sur les tables des librairies, des recueils évoquent notre lien aux vivants et à la terre. On parle de « bouche fumier », de « main rivière », de « corps de ferme ». Des revues comme Catastrophe, Les Haleurs ou Po&sie creusent le sillon. Des festivals d’écopoétique se montent et les ateliers d’écriture se multiplient à travers la France. En creux, s’esquisse le même impératif : réenchanter notre rapport au monde à l’heure du désastre, trouver des armes et des refuges, bâtir des cabanes de papier, « des barricades de mots ».
« La littérature doit sortir de sa réserve »
« Nous pleurons pour la planète et tremblons pour le futur. Ce nouveau sentiment tragique invite la littérature à sortir de sa réserve et à reprendre du service », scande l’universitaire et écrivain Jean-Christophe Cavallin dans son livre Valet noir (éd. Corti, 2021). Face à l’Anthropocène, nous avons besoin de nouveaux récits et interprètes. Nous avons besoin d’ouvrir des imaginaires à foison. Pour témoigner autant de notre désarroi que de nos colères.
Comment, aujourd’hui, parler des espèces anéanties sous nos yeux, du « mal de terre » qui nous saisit, de la beauté qui s’obstine à pousser ? Où puiser la force de lutter ? Comment rendre hommage à tout ce qui palpite et vibre autour de nous ?
La crise écologique est aussi une crise de la sensibilité. Et le poème a sûrement une place particulière à prendre dans cette partition, pour faire entendre plus précisément le son de la nature, le langage du vent et des ruisseaux, pour se rapporter délicatement à eux et faire pulser ce que Jean Giono appelle « le chant du monde ».
Sans beauté ni émerveillement, l’écologie risque de s’assécher. Sans renouer avec une forme d’attention et de soin, elle menace de se transformer en charabia d’ingénieurs. Depuis ses débuts, l’écologie a tenu sur ses deux jambes : la science, d’un côté, et la poésie de l’autre. La biologiste Rachel Carson n’a pas seulement écrit le Printemps silencieux en 1962, mais aussi Le sens de la merveille. C’est l’association entre sa connaissance scientifique et sa conscience poétique qui confère la force à ses livres.
« Quelque part
Une fleur s’ouvre
comme tes paupières sur le monde » — Marie Pavlenko
« L’écologie se vit dans la chair »
D’ailleurs, chez les précurseurs de l’écologie, la poésie est partout. Elle irrigue et fertilise leur pensée. Dans Le sens des lieux (éd. Wildproject, 2018), le biorégionaliste californien Gary Snyder compare « l’artisanat poétique » à « la descente en piqué d’un faucon ». « L’écriture de la nature a le potentiel de devenir le type d’écriture la plus vitale, radicale, fluide, transgressive, pansexuelle, subductive et moralement stimulante, écrit-il. Ce faisant, elle pourrait aider à arrêter une des choses les plus terribles de notre époque – la destruction des espèces et de leurs habitats, l’élimination définitive de certains êtres vivants. »
La poésie se ressent aussi dans les descriptions exaltées de John Muir qui s’accroche aux pins pour voir au plus près l’orage (Forêt dans la tempête). On l’entend chez Bernard Charbonneau et son amour du monde rural (Jardin de Babylone). Chez Aldo Léopold et son écoute patiente de la montagne (L’Almanach d’un comté des sables).
« La littérature a joué un rôle majeur dans l’émergence des pensées de l’écologie. Sans poésie, elles seraient même incomplètes, insiste l’éditeur Baptiste Lanaspeze. La révolution cosmologique de l’écologie n’entraîne pas seulement des changements d’ordre sociaux, politiques ou techniques. Elle se vit dans la chair, elle engage nos sensibilités. »
Or, qui mieux que le poète est capable de transmettre ces émotions et de les faire vivre ?
Pour Benoît Reiss, l’éditeur de Cheyne, une maison d’édition historique, le poète mène « un travail de sismographe des affects ». « La poésie est en contact, corps contre corps, avec le monde », dit-il.
« L’animisme tranquille du poème »
« Prêter l’oreille, discerner, entendre quelque chose non-parler, entendre le monde muet bruire d’idées, ça s’apprend, ajoute l’écrivaine Marielle Macé. Et les poètes, honneur aux poètes, sont là pour ça : prêter davantage l’oreille, élargir la perception, le faire savoir. » C’est ce qu’elle appelle « l’animisme tranquille du poème ». Écouter les forêts, les bêtes et les fleuves. Il n’y a rien de plus banal pour un poète !
« Surgissez, bois de pins,
surgissez dans la parole
L’on ne vous connaît pas
Donnez votre formule » —
Francis Ponge
Selon le poète Jean-Luc Pinson, il existerait entre la poésie et la nature un très ancien « pacte pastoral », une alliance multimillénaire avec le vivant. À une époque pré-urbaine, la poésie est née de l’écoute de la nature, d’un lien intime entre les hommes et leur milieu. C’est une quête de la présence.
« Tu voyais l’herbe ondoyer et tu faisais ondoyer les mots pour traduire ce qui de toi ondoyait aussi dans l’herbe » — Jean-Pierre Le Goff
Pour l’écrivaine Lune Vuillemin, la poésie écologique s’apparente à « un dialecte du territoire ». « Elle forme un nouveau dictionnaire de cette chose mouvante, changeante et tenace qu’est la nature ». Le travail d’écriture est une manière de « sentir qu’on fait partie du paysage autrement que par les traces qu’on laisse », raconte-t-elle.
Dans son dernier recueil Bouche fumier (éd. Cambourakis, 2023), Hortense Raynal recourt, aussi, au langage comme elle recourt à la terre. Elle esquisse une « poésie compost », les pieds dans la glaise. Elle fabrique le langage, bouture après bouture. « Le langage, c’est de la chair battue, du corps qui retourne à la terre pour la nourrir. »
« À la question “que peut la poésie aujourd’hui ?”, qui nous est régulièrement posée, à nous les poète.sses, je répondrai ça, dit-elle. La poésie peut, en mettant à l’œuvre en actes et en mots cette discipline, apporter une réponse collective à la détérioration du tissu relationnel entre les individus, entre les individus et les autres espèces, entre les individus et leur environnement, entre les individus et les forces qui les dépassent. »
C’est aussi ce que pense le poète Pierre Vinclair. Joint par Reporterre, il dit que « la poésie construit des nids de poule sur l’autoroute de la dévastation du monde ». La poésie ne sauvera pas la planète, certes, mais par contre, si tout le monde ne faisait que lire ou écrire de la poésie, la planète serait sauvée. « La poésie, c’est l’acte décroissant absolu. On peut passer deux heures sur un carnet à déchiffrer un poème, ça n’émet pas de CO2 contrairement à Netflix, ça ralentit le temps. »
Il ne faut pas déserter le langage, lieu d’une âpre bataille, assure-t-il. « Ce ne sont pas seulement des tractopelles et des tronçonneuses qui détruisent l’Amazonie, ce sont aussi des mots et des discours ». Contre la pensée bien dressée et la rationalité moderne, contre le langage productiviste, le poème est « un animal nerveux » qui refuse les bonnes manières, « une taupe souterraine plantée dans l’esprit humain qui essaye de faire éclater le tableau Excel pour mieux ensauvager le monde ».
https://reporterre.net/Ecologie-le-grand-retour-de-la-poesie
‘L’Arche dans la tempête’ d’Elizabeth Goudge, ‘Que ma joie demeure’ de Jean Giono, ‘Border la bête’ de Lune Vuillemin : et voilà, voilà le monde.
Après avoir lu Border la bête de Lune Vuillemin, qui vient de paraître aux éditions La Contre-allée, ils me sont revenus encore :
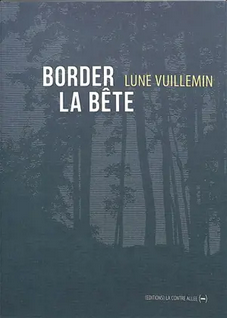
Quand le vent reprend son souffle, l’air se fige au-dessus du lac Petit. La glace soliloque sous le ciel blanc, parfois elle grince des dents, se met à rire et sa mâchoire claque. Sa peau blanche gercée de bleu semble forte et prête à recevoir les baisers ardents du printemps. Il y a d’abord une expiration de brume sur les sapins baumiers, puis le froid bondit d’un bout à l’autre du lac à la manière des chevreuils en fuite. Le chant de la glace rencontre le rire de la sittelle. Les trembles nus se tendent la main, si blancs et lourds d’une neige glacée. Dans la forêt, le pas silencieux des biches alertes, le ventre rond d’une mésange sur une branche tordue, une petite martre baille, dents minuscules et poils hérissés par une couverture de neige tombée d’en haut. Le matin pointe le long de la rivière Babine.Border la bête, p. 9, incipit
Dès l’incipit, on a l’impression de lire une autrice pour qui l’un des axiomes de Giono, faire chanter le monde, accorder autant de place, sinon plus, aux choses, aux bêtes, à la nature, qu’aux personnages humains, fut une leçon. Dans un des fragments de Solitude de la pitié, déjà évoqué ici, Giono écrit : «Il y a bien longtemps que je désire écrire un roman dans lequel on entendrait chanter le monde. Dans tous les livres actuels on donne à mon avis une trop grande place aux êtres mesquins et l’on néglige de nous faire percevoir le halètement des beaux habitants de l’univers. […] Je sais bien qu’on ne peut guère concevoir un roman sans homme, puisqu’il y a en a dans le monde. Ce qu’il faudrait, c’est le mettre à sa place, ne pas le faire le centre de tout, être assez humble pour s’apercevoir qu’une montagne existe non seulement comme hauteur et largeur mais comme poids, effluves, gestes, puissances d’envoûtement, paroles, sympathie. Un fleuve est un personnage, avec ses rages et ses amours, sa force, son dieu hasard, ses maladies, sa faim d’aventures. Les rivières, les sources sont des personnages : elles aiment, elles trompent, elles mentent, elles trahissent, elles sont belles, elles s’habillent de joncs et de mousses. Les forêts respirent» .
Or Lune Vuillemin nous raconte la retraite d’une jeune femme perdue dans un refuge pour animaux au fond de la forêt, et sa rencontre avec non seulement Jeff et Arden mais avec les bois, et un sapin baumier, et les habitants des bois, coyotes, castors, coccinelles, sittelles… loin des plaines dont elle vient. (Belle et juste façon, d’ailleurs, à mes oreilles, et que n’aurait pas reniée Giono je crois, de parler des plaines, dont arrive la narratrice, et dont vint avant elle Arden, et dont viennent selon le texte tant d’adolescents, et surtout d’adolescentes, de jeunes filles qui fuguent, qui fuient les saloperies des hommes pour les collines : «Cette région où il n’y a rien d’autre qu’une horizontalité infinie, des pluies de pesticide, des églises quasi vides et des journées interminables à l’odeur de papier peint.» – p.126). Retour à Giono un instant, à ce propos, avec cet autre passage de Que ma joie demeure. C’est Bobi qui parle :
«J’ai essayé, dit-il, de me faire une compagnie avec toutes les choses qui ne comptent pas d’habitude. Je vais vous paraître un peu fou et je dois l’être un peu. Je me suis fait doucement compagnie de tout ce qui accepte amitié. Je n’ai jamais rien demandé à personne parce que j’ai toujours peur qu’on n’accepte pas, et parce que je crains les affronts. Je ne suis rien, vous comprenez? Mais j’ai beaucoup demandé à des choses auxquelles on ne pense pas d’habitude, auxquelles on pense, demoiselle, quand vraiment on est tout seul. Je veux dire aux étoiles, par exemple, aux arbres, aux petites bêtes, à de toutes petites bêtes, si petites qu’elles peuvent se promener pendant des heures sur la pointe de mon doigt. Vous voyez? A des fleurs, à des pays avec tout ce qu’il y a dessus. Enfin à tout, sauf aux autres hommes, parce qu’à la longue, quand on prend cette habitude de parler au reste du monde, on a une voix un tout petit peu incompréhensible». Que ma joie demeure, p. 156, 157
L’ambition ici est de dire ce qui vit, tout ce qui vit, des plus petites bêtes à la grande orignale qui meurt dans les premières pages, des lumières du printemps aux craquements de la glace, et de rêver des noms pour tout ce qui n’en porte pas. Après Giono et ses pages incroyables sur, mettons, le vent, les narcisses ou les loutres, toujours dans Que ma joie demeure, la narratrice de Lune Vuillemin et son ami Jeff tentent d’élaborer un herbier sonore de la forêt, que conservera après leur départ Arden, la femme aux doigts comme des pattes d’araignée. Pas une mince affaire. Une autre, plus difficile encore, serait de dire l’homme et la femme depuis la langue des bêtes, comme le fantasme la narratrice. Nous n’y sommes pas encore :
Je suis autant attirée par la beauté de ce qui vient d’au-dessus que par le mystère de l’animal passé là tantôt, dont je rêve de croiser le regard. Je m’arrête parfois pour tourner sur moi-même. M’accorder au mouvement du matin, danser cette volte, parodier la neige. Sentir qu’on fait partie du paysage autrement que par les traces qu’on laisse. Comment les animaux décriraient-ils mon odeur ? Avec quels mots les arbres parleraient-ils de ma démarche, du poids de mon corps sur le sol ? Les pas du renard disparaissent peu à peu sous une nouvelle couche de poudreuse et me mènent à un marécage encore pris par la glace. Tout autour les touffes d’herbes et leur couleur de miel sombre qui se reflètent dans la glace floutent ce territoire que j’arpente et découvre. Parfait camouflage pour la solitude qui soudain me prend à la gorge.‘Border la bête’, p. 47
L’héroïne de Lune Vuillemin s’inscrit sans doute dans la lignée de ces personnages, le Ranulph d’Elizabeth Goudge et le Bobi de Giono, qui, dans leur solitude profonde et blessée, arrivent, du monde et par la mer au fond d’une barque, de la ligne d’horizon, «homme posé sur le large du plateau de Grémone avec la stature et la lenteur d’un arbre» (Que ma joie demeure, p. 21, 22), ou de l’adolescence, de la plaine, de la violence, du deuil, et qui changent le monde où ils sont accueillis, d’une façon ou d’une autre, en tâchant de l’écouter.
Alors qu’elle fuit, désespérée, suite au deuil d’un être cher, la narratrice assiste par un concours de circonstance à la tentative de sauvetage d’un orignal. Devant ce lac gelé, elle découvre une femme, un homme et leur volonté tenace de donner une chance au vivant de survivre. Fascinée, elle décide de rester et de travailler à leur côté.
Après Quelque chose de la poussière (2019), Lune Vuillemin publie son deuxième roman Border la bête. Dans son récit, elle décrit une nature omniprésente. Ayant vécu au Canada pendant deux années, elle s’inspire de ces paysages nord-américains pour donner forme à son livre. On entre dans des forêts denses, parcourt des tourbières, croise des rivières et des lacs.
Dans cette vallée enneigée, la narratrice est accueillie par Jeff (un homme à la sensibilité exacerbée à qui il manque un œil) et Arden (la femme aux doigts arachnéens) qui la loge tout au long de son expérience. Admirative, elle découvre leur dévouement à toute épreuve envers ces animaux. À toute heure, ils vont chercher ratons laveurs, renards, loutres, opossums et autres bestioles blessées où qu’elles se trouvent. Ils les extraient des pièges, les ramènent pour les guérir et les aider à recouvrer leur liberté.
La grange n’a pas fière allure, mais je ne sais pas encore qu’à l’intérieur il fait chaud et qu’on y couve la vie. (…) Entrer dans la grange, c’est un peu comme se faire tout petit dans l’antre d’une bête qui hiberne. C’est plein de respirations chaudes d’animaux endormis, de murmures, de faim, de l’odeur du foin trempé de pluie, d’urine et de selles. (…) La grange est à la fois suffocante et rassurante. Tout de suite je m’y plais. Border la bête – Lune Vuillemin
« Il nous faudrait, en fait, inventer un dialecte du territoire, former un nouveau dictionnaire de cette chose mouvante, changeante et tenace qu’est la nature ». Dans son récit, l’autrice pense la porosité entre humain et non-humain. Elle ne distribue pas les rôles selon le scénario classique du face à face nature/culture. Elle préfère observer les intrications inquiètes et les entremêlements silencieux qui peuvent exister entre toutes strates du vivant. Dans une prose subtile et précise, elle dit ce monde à l’atmosphère glaciale où les coyotes dansent en cercle autour d’Arden, où une coccinelle choisit le nombril d’une humaine comme nid et où une rivière prend la parole si on lui tend l’oreille.
Lune Vuillemin signe un roman d’une profonde humanité. Avec Jeff, la narratrice tisse une amitié puissante qui croît à mesure qu’ils se promènent et prêtent attention au langage cryptique et sensoriel de la forêt. Un herbier sonore né de leur décision de répertorier dans un carnet les bruits sauvages perçus. En avançant dans l’histoire, la narratrice voit les reliefs se superposer aux corps. Des branches, des falaises, des noeuds semblent peupler le corps d’Arden. Peut-être est-ce là un des effets de son désir grandissant pour elle. Ensemble, elles parlent peu mais une évidence physique se révèlent dans leur corps à corps sensuel. Cette entente muette révèle leurs souffrances passées avec plus d’intensité que si elles avaient été passées par le tamis du langage.
Border la bête met en lumière toute l’ambivalence dont la main humaine est capable : blesser, chasser, abattre mais aussi réparer, prêter secours, prendre soin. Lune Vuillemin pense la folie de destruction, la possibilité de tisser des liens forts et l’indicible douleur laissée par la disparition des êtres aimés.
Border la bête de Lune Vuillemin, éditions La Contre Allée, 19 euros.
Effleurer l’insaisissable, saisir les sons, et sensation, d’une sauvagerie sylvestre, accepter la perte mais surtout le contact à autrui, à sa tendresse et à cet animal qu’un instant, en lui, on peut trouver. Quelque part dans une septentrionale forêt, la narratrice cherche le secours d’un refuge animal, apprend, dans une très jolie lumière ambrée, au seuil de la forêt, à composer avec ses peines, à aimer sans le dire ces deux très belles présences qui recueillent les animaux blessés. Border la bête plonge dans un territoire, nous en fait entendre la langue, les éternels interstices de sens comme on espère un contact retrouvé à soi et au monde, comme on s’inscrit dans une poétique qui redéfinirait notre participation à un environnement qu’il ne s’agit plus de dire nôtre. Lune Vuillemin signe ici un roman d’une belle, fragile, intensité où elle parvient à faire résonner la traversée, éperdue, d’une âpre sagesse contemplative.
Il faut le dire, malgré la surproduction littéraire, en dépit de l’impression de n’avoir pas entièrement le temps pour laisser les textes se développer, on parvient encore à être très agréablement surpris, à nous laisser porter par la découverte d’une sensibilité qui, dès lors, se construirait par et dans une langue. On pourrait, certes, inscrire Lune Vuillemin dans ce qui serait une éco-poétique. Le terme, dans le cas de Border la bête, serait à mon sens trop réducteur, charriant peut-être même une manière de se fondre dans un discours, et ses diktats, strictement contemporain. Il me semble qu’il faille remonter plus haut, ailleurs. Lune Vuillemin, s’il faut absolument l’enferrer dans des références, semble plutôt poursuivre la tradition du nature writing, dans l’écoute de la nature qui ne veut pas uniquement répondre à la légitime angoisse écologique, mais en écouter, en dépit de tout, la beauté dans ce qu’elle a d’inaccessible, de destructeur sans aucun doute. Même si la comparaison est un peu grande, on a pensé parfois à Jim Harrison, par la description de, disons, cette sagesse sauvage, un peu brusque et tacite. Au bord d’un lac, dans une assez impressionnante scène d’ouverture, une originale meurt, prise dans les glaces. On s’ouvre alors à l’évidence du double sens du titre : Border la bête serait s’approcher au plus prêt de ses bords, mais aussi, comme on se couche, tenter de l’endormir pour, qui sait, mieux en entendre les rêves. Ce sera d’ailleurs un des grands attraits de ce roman : sa présence fantastique par-delà l’histoire très incarnée de cette narratrice, en errance, qui trouve refuge, littéralement, chez Arden et Jeff, dans un refuge donc pour animaux où, dans le soin, elle trouvera, dans l’écoute, une place, ou pour mieux dire une absence : « Moi j’ai l’impression de monter sur une scène où se joue une pièce de théâtre, et plus j’y réfléchis, plus ma présence désamorce l’acte en cours. Je cherche toujours un rôle à ma pensée. Qu’est-ce qui se tait quand nous sommes là ? » Par cette excellente question s’ouvre peut-être la possibilité de l’extériorité, de l’écoute. C’est, me semble-t-il, un des charmes de Border la bête : son exploration de cette absence perceptive. Nous avons tenté de le traverser dans L’épreuve de l’individu : une partie de la littérature contemporaine semble habiter par l’envahissante consciente surplombante de l’auteur, par sa volonté de commenter, de s’approprier, de montrer à quel point il se sert de tout ce qu’il vit, son récit. Nous avons dans le roman de Lune Vuillemin un travail de fiction, d’effacement, d’outrepassement véritablement intéressant.
Je note quelques mots dans le petit carnet, pour notre herbier sonore, mais ce sont surtout des mots de vide, d’absence, de secret, d’impalpable. «
Cet herbier sonore est une très belle trouvaille : Jeff et la narratrice vont dans la forêt qui borde, donc, le refuge. Dans le seul secours que, sans doute, peut nous apporter autrui, Jeff lui suggère de noter ses impressions de la forêt, ce qu’elle peut entendre, percevoir de son mystère fondamental. « La forêt regorge d’histoire et elles ne sont pas les nôtres. » La découverte de ce que l’on est passe sans doute par ce silence, par l’effleurement de ce qu’autrui ne saurait nous dire. Border la bête, toujours très simplement, dans la certitude de la contondante certitude que constitue l’irréfragable douleur d’autrui, parvient à nous faire entendre le récit. La narratrice peu à peu révèle ce qui l’a conduit là, dans une sorte de silence et de suggestion des motifs de sa fuite, dans l’écoute surtout de ce qu’elle peut en entendre d’autrui. Reste alors l’exténuation des jours, simplicité et soins aux animaux et soudain l’attraction qui peut renaître. Il faut suggérer la beauté de cette lumière ambrée qui, comme la présence d’un deuil, accompagne la narratrice, se révèle à elle au cœur de la forêt. Sans trop en faire tant le style de Lune Vuillemin, on l’a suggéré, impose ceci comme une évidence, un vécu. Par petites touches, tout en suggestion, écoute on se répète d’une histoire qui n’est pas nôtre, l’autrice dévoile le très beau personnage d’Arden, l’attraction amoureuse qu’elle fait naître. Tout ceci est dit dans une sorte d’apprêté, on allait dire, si nous ne redoutions pas le cliché, dans une sauvagerie que rien ne vient domestiquer. Admirablement, le récit fonctionne. Le drame et la séparation, toujours, rôdent : « En quittant les bois, j’y laisse mes odeurs, la lumière ambrée et quelques mots que je n’ai pas réussir à saisir. » Dans une métaphore bestiale qui, à l’écrire, paraîtrait presque trop évidente, la forêt est traversée par la Babine, perpétuelle et intangible présence. La perte, sans réparation, se reproduit, la beauté de Border la bête sait en faire écouter la nature constitutive de chacune de nos perceptions que Lune Vuillemin approche au plus près.
Un grand merci à La Contre-Allée pour l’envoi de ce beau roman.
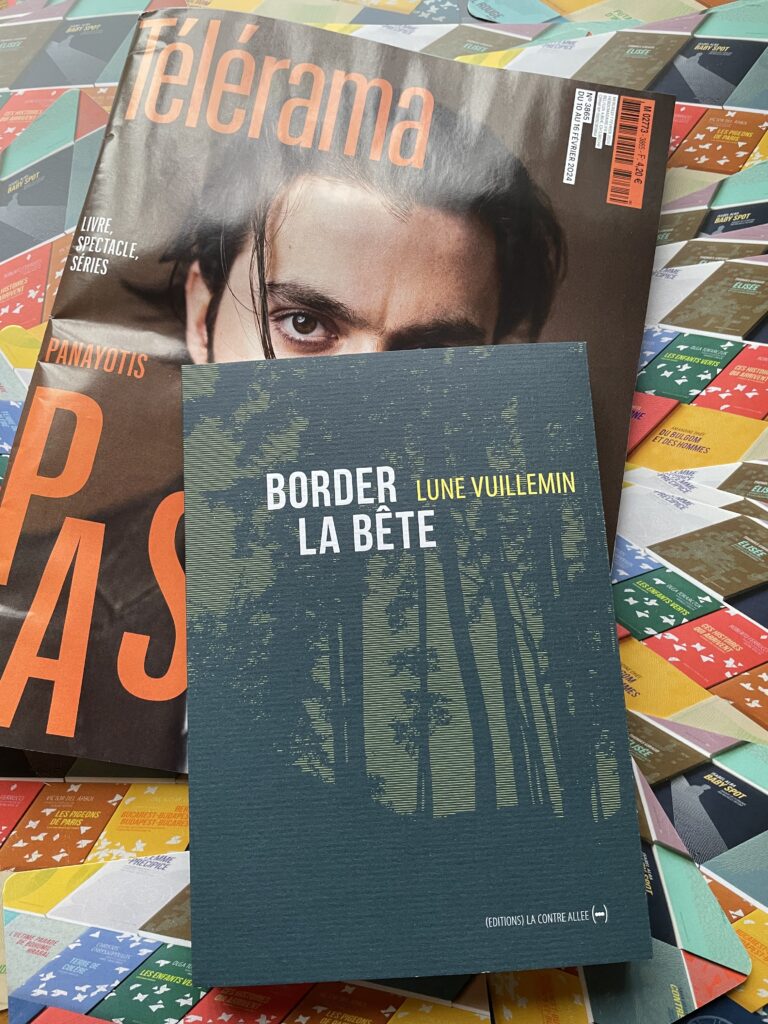

Camille Ardiot de la Librairie Préférences présente Border la bête.

En deux mots
Après la mort d’un proche, une femme décide de partir vers l’océan. En pleine nature, elle va croiser la route de Jeff et d’Arden au moment où ils tentent de sauver une orignale. Un respect pour la vie qui la pousse à faire étape chez eux. Au côté d’Arden, elle va retrouver un sens à sa vie.
Au sortir de l’hiver, la narratrice décide prendre la route et d’affronter une nature encore hostile. Un voyage ressenti comme une nécessité, après la mort de l’homme à qui elle devait tout et qui travaillait à ses côtés dans une brasserie. Chemin faisant, elle croise deux personnes qui s’affairent autour d’une orignale prise dans la glace et qui vont réussir à la sortir de ce mauvais pas. Elle va alors se joindre à Arden et Jeff qui lui propose de l’embaucher dans sa ferme. Au fil des jours, elle apprend à mieux le connaître et va lui confier son histoire. Quand Jeff lui demande d’où elle vient, elle lâche: «J’aurais pu te dire que je venais de voir un homme mourir, que je n’avais pas dormi depuis deux jours parce que je faisais du stop pour me rapprocher de la côte et que je voulais voir l’océan parce que j’avais l’impression qu’il me soignerait de la mort. Peut-être que j’aurais dû te répondre Je viens d’un endroit où l’on brasse du houblon dans de l’eau, un endroit imprégné d’eau qui sent parfois l’amer, le clou de girofle et les produits d’entretien. Je travaillais pour un homme que j’aimais comme un père et qui est mort tôt un matin pendant que je dansais dans la pièce d’à côté en écoutant The Clash. J’ai ses cendres dans mon sac, chez Arden. Je ne sais pas quoi en faire, je me suis dit que l’océan ça lui plairait. Mais en fait je ne sais pas trop.»
Une confidence en entraînant une autre, Jeff va lui raconter comment il a rencontré Arden et combien elle a souffert, victime d’un frère-bourreau.
En parcourant la contrée, en cherchant à sauver des castors ou un renard, les deux femmes vont se rapprocher, se reconnaître, s’aimer. «Faire l’amour avec elle, c’est comme grimper un séquoia géant à mains nues, une fois arrivé à la cime on regarde en bas avec le vertige, surtout ne pas tomber mais surtout ne pas redescendre non plus, lâcher le cœur qui sursaute comme un animal.»
Mais est-il besoin de rappeler que les histoires d’amour finissent mal? Lune Vuillemin va en apporter une nouvelle preuve avec une écriture pleine de sensualité et de poésie. En situant la rencontre entre la narratrice et Jeff et Arden au début du printemps, elle fait communier la fin de la période de deuil et le renouveau de la nature, elle fait renaître l’espoir, sans pour autant masquer les périls qui la menace.
Ajoutant une dimension onirique à sa quête, elle réussit un roman qui s’ouvre aux grands espaces.
On pense bien sûr à Thoreau et à ses disciples américains, mais aussi aux francophones Sylvain Tesson et sa Panthère des neiges ou encore à André Bucher avec La Montagne de la dernière chance. Deux noms auxquels il conviendra désormais d’ajouter celui de Lune Vuillemin.
J’ai aimé « Babine » la rivière chantante, Jeff et son « herbier sonore », Arden la taiseuse, le sapin baumier, les trois « Tannerites », les opossums, le renard galeux, les coyotes dansants et autres coccinelles qui peuplent et incarnent cette forêt ; Ce tout, où les humains et non humains ne font qu’un.
On voit, on sent, on ressent, on goûte, on touche, on entend ces lieux habités.
C’est un nature writing puissant, immersif, d’une étrange beauté dont on ne ressort pas indemne.
J’adore.
https://www.bouillondelecture.fr/coups-de-c%C5%93ur/border-la-b%C3%AAte-de-lune-vuillemin
| S’inspirant du nature writing dans son roman Border la bête (éditions La Contre Allée, à paraître le 12 janvier 2024), Lune Vuillemin exorcise les blessures internes de sa narratrice. Assistant au sauvetage d’un orignal, elle fait la rencontre de deux êtres comme on en fait peu : Arden et sa maison à l’odeur « chiens-poils-cuir-écorce-terre-femmes », et Jeff, l’homme à l’œil mort. Tous deux s’occupent d’un refuge au cœur de la forêt, travaillent pour les animaux et non « avec eux ». Le duo propose à la narratrice de rester et d’y œuvrer aussi, malgré la grande difficulté des tâches qui lui seront attribuées. Dans une langue pleine de silences et de pudeur, les trois personnages évoluent dans un écosystème brut, orné de poésie et de violence. Là où la vie et la mort se côtoient sans arrêt et devant lesquelles l’impuissance prend une place prépondérante. Cet environnement bucolique deviendra peu à peu le lieu de toutes les reconstructions pour enfin respirer à nouveau. Lune Vuillemin livre un roman qui nous pousse à exercer une langue nouvelle, porteuse de mille possibilités. Un roman incontournable de cette rentrée. |