
Télérama
Article de François Gorin dans Télérama publié le 26/06/18. (lire directement ici)
Karen Dalton, Jackson C. Frank, le salut par le livre ?
Deux légendes du folk, deux vies tragiques, deux talents reconnus par leurs pairs mais demeurés obscurs. Deux petits ouvrages récents rendent hommage, l’un à la chanteuse indomptée, l’autre au songwriter empêché. Leurs styles diffèrent, leur but est sincère, leur démarche interroge.

Elle (1937-1993) : deux albums de son vivant, plus quelques archives post-mortem. Lui (1943-1999) : un seul album en 1965, plus quelques démos exhumées. Deux destins contrariés. Deux dont la gloire n’a pas voulu. Deux légendes obscures. Assez pour nourrir un livre ? Oui, si l’on en croit des parutions récentes : Karen Dalton – le souvenir des montagnes, par Pierre Lemarchand, chez Camion Blanc ; La Ballade Silencieuse de Jackson C. Frank, par Thomas Giraud aux Editions La Contre Allée. Deux ouvrages d’un format nécessairement réduit, entre 150 et 200 pages et on peut considérer que c’est déjà beaucoup, au regard d’une matière plutôt mince dans les deux cas.
Deux approches différentes aussi. Côté Lemarchand, on cumule tout document ou témoignage à disposition, certains offerts par les livrets des rééditions des CD de la chanteuse et ceux des compilations de morceaux live ou home made éditées plus récemment : Cotton Eyed Joe et Green Rocky Road (Megaphone) et 1966 (Delmore). Ce déséquilibre entre la discographie posthume de Karen Dalton et sa production de son vivant n’est pas anodin. Malgré ses efforts et ceux des musiciens, producteurs et mentors qui l’entouraient, la fille de l’Oklahoma est restée une enfant sauvage, rétive à se laisser capturer par les techniques d’enregistrement, encore moins par un music bizness qui ne sut que faire de son talent brut.
Les albums studio de Karen Dalton sont frustrants. On est forcément touché par sa voix de blueswoman folk (quelque chose de Billie Holiday, de Bessie Smith) et on sent qu’elle n’est pas tout à fait dans son élément. Comme si le moindre habillage brûlait la peau de sa musique. L’affaire ne s’éclaircit qu’en partie avec les bandes exhumées. Le live de 1962 renvoie là où est née sa légende, au temps où elle épatait même le jeune Bob Dylan. La captation de 1966 nous emmène en ce coin montagneux du Colorado où elle avait élu domicile, près des chevaux qu’elle préférait aux hommes. On est peut-être plus touché encore par les images tournées quelques années plus tard au même endroit pour la télé française. Là crie l’évidence de sa musique pure et métisse, brillante d’être impolie ; sa beauté étrange, mi-cherokee, mi-irlandaise. Là murmure avec insistance que cette femme et cette musique n’étaient pas pour le monde où le talent se vend et où la gloire se paie.
Ni mérite, ni malédiction, c’est un fait. Cette image révélée sert de point de départ au livre de Pierre Lemarchand. Il aurait pu s’y arrêter, en faire un objet de rêverie. Il a préféré l’enquête et la collecte, allant même à la rencontre de quelques seconds rôles. Mais cette somme au fond n’en dit guère plus que ce qu’on voit (et entend) dans le bout de film susdit. Les aléas de la dure vie de Karen Dalton, amoureuse fantasque, mère à temps partiel, toxicomane, fuyant toute convenance en guettant des signes de reconnaissance, font les chapitres d’un roman triste. Il est plus que suggéré par ses disques. Et peut-être a-t-on tendance à magnifier ceux-ci au-delà du raisonnable, en compensation de leur faible écho public.
L’histoire de Jackson C. Frank est plus édifiante encore. La France rock a toujours chéri les losers et sans doute la noblesse des causes perdues nous revient-elle comme un devoir. Le folksinger de Buffalo n’a laissé à la postérité qu’un album. Il commence à l’enregistrer à la p.100 du livre de Thomas Giraud. On est en juillet 1965, à Londres. Il a fallu bien des détours au musicien, comme à son biographe, pour en arriver là. Avant même de peiner à promouvoir son talent, Jackson C. Frank souffre de simplement l’exprimer. Pour lui-même d’abord, perfectionniste voulant traduire en sons l’effet que lui font les couleurs des peintres. Ou devant un public, comme ce sera le cas de Nick Drake — un de ceux à l’avoir le mieux écouté.
Mais le terrible défaut d’assurance de JCF le poursuit en studio. Même couvé par son premier admirateur Paul Simon. Isolé derrière un paravent, le chanteur parvient à livrer dix morceaux, dont quatre splendeurs au moins : Blues run the game (la plus reprise, notamment par Simon & Garfunkel), Milk and honey (Sandy Denny en fit une version), le poignant madrigal I want to be alone et My name is carnival, préludant au premier Tim Buckley. Il est tentant de comparer Jackson C. Frank à des pairs à la légende plus étoffée. Son picking proche de l’Ecossais Bert Jansch. Sa voix, sans l’expressivité lyrique de Tim Buckley, ni la grâce éthérée de Nick Drake. Même s’il avait le pouvoir de charmer, il n’en aurait pas l’envie. Il joue juste et chante bien, s’investit dans ses compositions. Mais ça n’a pas suffi.
Al Stewart, qui l’a accompagné, témoignera sur la suite : « Il a commencé à jouer des choses complètement impénétrables. » Frank est rentré aux Etats-Unis, s’est marié, installé à Woodstock, a perdu un fils, s’est fait interner, diagnostiqué schizophrène. Revenu vivre chez ses parents, puis à New York, il mourra d’une pneumonie après avoir essayé en vain de retrouver Paul Simon. Bien avant cette triste fin, Thomas Giraud fait grand cas d’un traumatisme d’enfance : à onze ans, Jackson a réchappé de l’incendie de son école mais avec des séquelles. On a prélevé un morceau de sa cuisse pour le greffer sur la partie brûlée de son visage. Blues dans la peau et claudication. Fatalité ? Est-on né pour la poisse ?
La Ballade Silencieuse… s’attache à des détails signifiants de cette vie tragique et les romance. On tourne autour, moins d’une énigme ici que d’un vide, d’un non accomplissement. Plutôt que de révéler les failles d’un musicien, les chansons de Jackson C. Frank traduisent une quête, douloureuse et stoïque, pour les surmonter. L’écriture alors peut fournir sur ce personnage littéralement désolé, un éclairage, sinon une prise. Tout tient au choix de la bonne distance. Au-delà d’une intention sincère — offrir sa chance au loser —, l’exercice demeure périlleux.







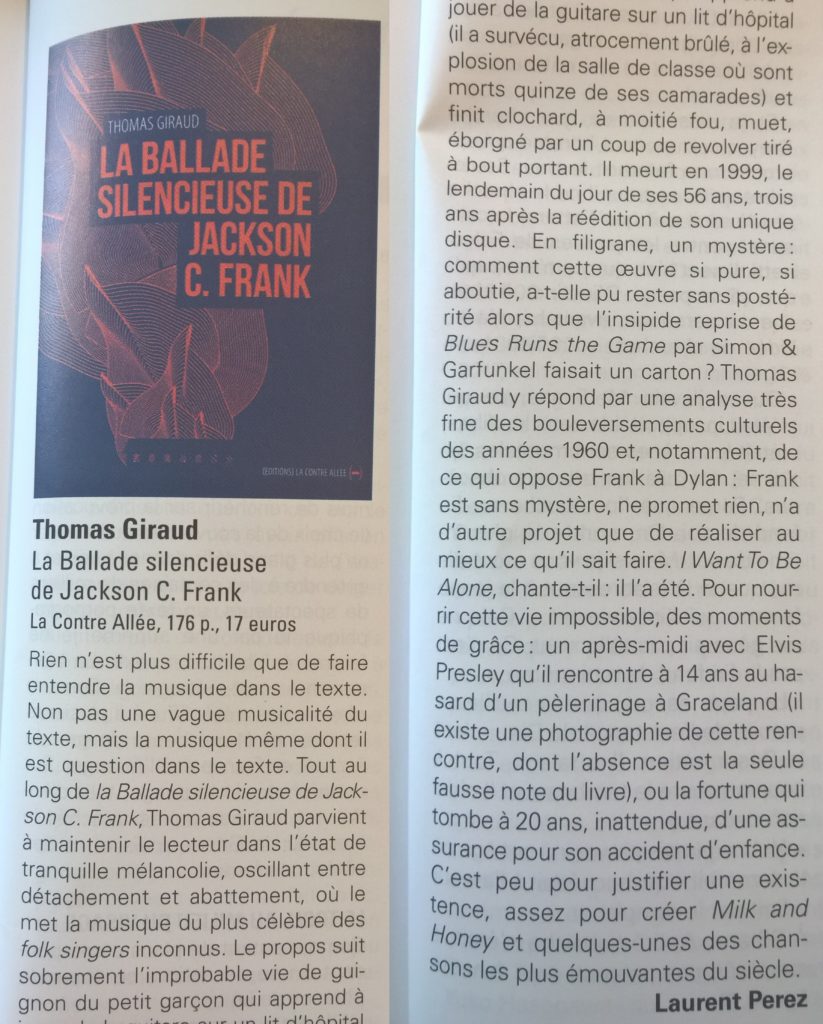


:format(jpeg):mode_rgb():quality(90)/discogs-images/R-2983843-1348246155-7389.jpeg.jpg)









