Bastille magazine (mai-juin 2025) par Marine Brugier-Dutournier


Galoper, galoper pour fuir les Chevals morts, ceux qui cherchent la faille, la brèche pour s’engouffrer et pousser l’autre à la faute, à la fuite. Chercher la peur. La tristesse et y aller. Au galop. Alors il y a celui qui lutte contre ces Chevals morts. Contre le temps qui joue contre nous. Contre les corps. Contre l’amour. L’amour fragile. L’amour au bord du précipice. L’amour qui semble échapper à l’autre. Qui tente de le retenir, la peur au ventre, de voir l’autre regarder dans une autre direction.
« je veux être comme cet homme, que la chaleur de ton cul soit la chose la plus précieuse au monde
la chaleur que ton cul diffuse aux objets sur lesquels tu t’assois, qu’elle soit toujours divine absolument
même si ton corps est loin de moi même si tu t’es levée avant moi, je serai là pour sentir la chaleur de ton cul là pour la retenir là pour en jouer et que mon sourire soit l’épouvantail le plus obscène du monde contre la course des chevals morts sur la lande »
Il y a celui qui prie de mots tornades, avec une tristesse qui lui colle à la peau, une tristesse presque enfantine. Une de celle qui dit « ne me quitte pas ». Une incantation dans une langue sacrée. Celle de l’amour. Où tout prend vie. Le beau, le triste. La peur, l’espoir, l’attente. La course. Contre le temps qui passe et qui n’arrange rien à l’affaire. Contre la mort qui rôde.
En à peine 30 pages, Antoine Mouton nous adresse un poème dessin. Magnifique, intense, éclatant. Des mots qui fourchent et dérapent parfois comme pour montrer l’angoisse qui se noue. L’inévitable qui se dessine. Des mots qui pressent, qui claquent, qui vont et viennent. Des mots musiques. Des mots refrains. Des mots poursuites.
Des mots à découvrir.
« il y a tellement de gens seuls dont on dirait qu’ils ont perdu des morceaux d’eux-mêmes il y a tellement de morceaux de gens qui ne sont plus eux-mêmes après avoir perdu quelqu’un je ne voudrais pas, nous, qu’on se perde et qu’on se morcelle…»
Les chevals morts sont des histoires d’amour, de celles qui nous tiennent la main, le cœur, quine nous quittent pas quand tout nous quitte, quand la vie semble au bord des gouffres, la tristesse gagner le jour, quand les mots insensés deviennent chanson de Brel, de Barbara, des actes d’amour que seuls les chevals morts peuvent comprendre, entendre, aimer. Les chevals morts sont un hennissement silencieux, un trot au pas pas pas pas galop, pas trop vite, pas, cataclop cataclop sublimant l’ode du vide, de l’abandon encore et toujours possible, des désirs qui restent quand l’autre semble s’enfuir, fuir.
Antoine Mouton a ce trait d’écrire ce qui semble impossible à écrire, à dessiner de mots, les tristesses invisibles, les amours désirs, les amants évidents. Il déploie les mots dans un romanpoème prose, une poésie prose roman sans se soucier des cadences à donner, des mouvements à prendre, des vertiges désirables. Il contourne l’écriture, donne sa variante, sa mesure, son trot galop au pas, sa pensée. L’amour embrase la mort et l’inverse se fait. Les écrits se lisent qu’importe le souffle, le sentiment, le halètement, la direction à suivre. Le jaillissement avant le possible, le peut-être, l’instant de grâce absolu, la poésie.
« les chevals morts se nourrissent de nos erreurs du foin de nos erreurs de tout ce foin qu’on fait entre leursdents, avec nos erreurs […] ils ont l’air plutôt tristes et silencieux ils crient mais on ne leur parle pas ils hurlentmais on leur demande de se taire et le pire c’est qu’ils obéissent »
Il faudrait lire à voix haute les chevals morts, s’en faire une danse indienne, une danse de joie,une danse de mots, un brasier, un sacrement aux possibles toujours et encore, aux désirs quis’enfuient, enfouissent et qui renaissent à la grâce d’une simple main posée, d’un éclat d’une langue écrite juste pour ce moment où… Il faudrait le lire dans le creux de l’oreille, celle de la joie, de l’envolée, de la pudeur démasquée, des sexes avant l’embrasement, les rythmes et recueils dans les landes, avant les peut-être, les écueils, les ce serait mieux ou moins ou pas …, avant les tristesses et les solitudes, les peurs et les abandons, les pensées tristes, les absences, avant que les chevals morts ressurgissent dans un galop, une danse sur la lande, une chaleur hennissement.
Peut être que les chevals morts ne sont jamais aussi beaux que lorsqu’ils tirent la tristesse pour en faire un chant d’amour. Peut être que les chevals morts sont ce chant. Le chant des erreurs mais pas des fautes. Le chant des peut être mieux, le chant des peut-être. Peut être que les chevals morts…. Peut être…
« les chevals morts sont dans les mots un seul suffit nous n’avons pas le droit à l’erreur les chevals morts nenous rattraperont pas les chevals mort ne nous rattraperont pas »
Un article à retrouver ici.
Une chronique de Jean-Yves Copin, pour Gestions Hospitalières, dans le n° 619 d’octobre 2022 :
Entretien d’Antoine Mouton, pour Un dernier livre avant la fin du monde, publié le 4 octobre 2022, par Adrien :
Dans cet entretien, Antoine Mouton nous offre son regard original sur la littérature et la pratique de l’écriture. Écrivant à la fois de la poésie et du “roman”, l’écrivain forge une œuvre à part dans le paysage littéraire, où se déploie une réflexion sur le temps et les relations entre chaque être humain.

Toto et Les Chevals sont effectivement deux facettes, deux mouvements très différents de mon écriture. Le premier est la tentative de répondre à ce fantasme que j’ai longtemps eu d’écrire un roman, fantasme qui est un peu tombé depuis cette publication, car je ne veux plus écrire que des textes désormais, sans me soucier de ce qu’ils devraient être, et parce que le mot roman se charge bien trop à mon goût du fantasme des autres en réalité, de fantasmes hérités en quelque sorte, et plutôt collants. Et j’aimerais, bientôt, non pas réconcilier prose et poésie comme je l’entends dire quelques fois, mais tout simplement écrire, et donner à lire ce que j’écris, sans vouloir mouler cela dans une forme plus ou moins identifiable. Je crois que j’ai passé le cap de l’identification, du désir d’être identifié.
Les Chevals morts, c’est un poème, épique, amoureux, qui vient chercher le souffle et la scansion, qui vient chercher le sentiment et son éclat par la rapidité des phrases et leur élan. C’est l’apparition de l’amour dans une vie plutôt solitaire, en tout cas sculptée par le goût de la solitude. Et un jour la sculpture s’effrite, l’amour la fait tomber, et voilà ce qui reste : un poème, une adresse à l’autre.
Et Toto est un livre qui met en scène un couple enfermé. On pourrait penser que le ton est cynique ou désabusé mais je ne crois pas : c’est un livre qui tente de dire tout ce contre quoi l’amour se bat pour ne pas mourir étouffé. Alors, dans Toto, je saisis l’amour à cet endroit de l’étouffement presque définitif, au moment où Les Chevals morts ont déjà bien endommagé l’espoir, mais la colère est encore là, et la lucidité, et le désir de sortir du couloir de peine où l’on nous et s’enferme. Dans Les Chevals morts, c’est un mot qui fait image, plutôt lyrique ; dans Toto, j’ai choisi la voie comique pour décrire cette menace. Mais dans les deux textes, c’est le presque qui compte. L’amour presque étouffé. Alors possible quand même.
Je ne dis pas qu’il n’y a pas de frontière, mais je voudrais trouver autre chose qu’une conformité à l’une ou l’autre de ces pratiques. Car ma pratique quotidienne de l’écriture est plus proche du journal, ou plutôt du carnet.
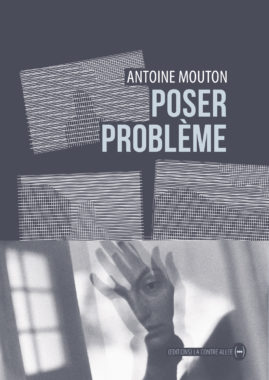
Pour moi le poème est débarrassé de fantasme. Parce que le poème, c’est l’inconnu. Alors écrire un poème c’est écrire ce qu’on ne sait pas, il y a donc forcément une rencontre au bout de ça, on aura plongé dans l’absence d’un savoir, on aura fait face à sa propre ignorance. Peut-être que derrière le mot “poésie” il y a un espoir – mais je ne me dis jamais que j’écris “de la poésie”, seulement “des poèmes”.
Et c’est ce qui est arrivé avec Poser Problème. Poser Problème est un ensemble de poèmes, qui peu à peu ont eu tendance à faire corps. Je les écrivais sans trop penser au dessin global qu’ils formeraient une fois réunis, mais je voyais bien que quelque chose se dessinait quand même. Et quelque chose s’activait en moi aussi, puisque je me mettais à écrire des poèmes qui venaient répondre à d’autres, comme si le recueil se formait par un jeu d’appels et d’échos. Alors c’est devenu cette journée, parce que finalement c’était la question qui animait chacun des poèmes du recueil : comment on traverse une journée ?
Toto perpendiculaire au monde est beaucoup plus construit, c’est le résultat d’un projet. Même si le point de départ est venu d’une insomnie, pendant laquelle je me suis levé, et où j’ai aperçu, dans la rue en bas de chez moi, des gens qui jouaient avec des ballons. Aussitôt il y a eu une première phrase, le prénom du personnage principal, celui du visiteur occasionnel, Jean-Max, la chambre, etc… Le monde dans lequel mes personnages allaient évoluer s’offrait spontanément. Je savais que Toto et sa femme seraient des lecteurs de nouvelles, alors j’ai commencé à écrire les nouvelles qu’ils reçoivent du monde extérieur, pendant un an et demi à peu près. J’imaginais que toutes les nouvelles seraient dans le livre. J’en ai supprimé énormément, mais au début mon idée était d’articuler l’histoire de Toto autour de ces nouvelles. Et là aussi, ça m’a pris un an et demi. Et puis à l’assemblage, j’ai vu que ça ne tenait pas vraiment, qu’il fallait réduire le nombre d’histoires parallèles, recentrer le récit sur l’évasion de Toto et sa femme.
Poser Problème aussi parle d’évasion, vous avez raison. D’évasion ou plutôt : comment habiter le temps ? Comment habiter chaque heure, chaque minute du jour qui vient ? S’il faut sortir, c’est plutôt des catégories, des logiques, des absences à soi-même et au monde. Mais la voix veut rester, elle. Ou du moins elle veut être là.

Je ne dis pas qu’il n’y a pas de frontière, mais je voudrais trouver autre chose qu’une conformité à l’une ou l’autre de ces pratiques. Car ma pratique quotidienne de l’écriture est plus proche du journal, ou plutôt du carnet. J’ai un carnet, et dedans j’écris des poèmes et je raconte des histoires, sans souci d’équilibre ni d’unité, et parfois j’entame une histoire qui se transforme en poème…
Longtemps j’ai cru que cette chose-là était illisible, beaucoup trop “crue” et décentrée, qu’elle manquerait forcément d’unité. Mais mon prochain livre, ce sera le carnet avec ses poèmes et ses récits entremêlés, n’ayant pour loi que le temps. C’est Isabella Checcaglini des éditions Ypsilon qui m’a encouragé à suivre cette voie. Elle savait ce sur quoi j’écrivais dans mon carnet, et elle m’a dit qu’elle voulait le lire. Elle le publiera au printemps prochain.
J’ai lu aussi le livre de Gaëlle Obiégly paru en septembre chezBourgois, Totalement inconnu, que j’ai trouvé très libre dans sa conduite. J’ai eu l’impression, en le lisant, que Gaëlle Obiégly l’avait écrit au plus près de son désir ou de sa pensée ou de son hasard intérieur, au plus près de son désordre peut-être. Ça m’a ouvert une voie pour la suite.
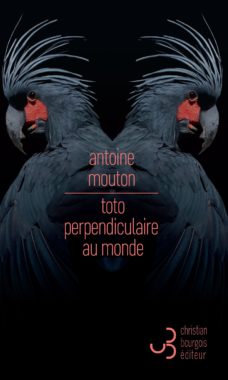
Toto est un livre qui se situe dans le quartier où je vis depuis plus de dix ans. Je n’avais jamais habité aussi longtemps quelque part, quand j’étais petit on déménageait très souvent et je n’ai donc pas de lieu d’attache où revenir et voir comme le temps a passé. Dans tous ces lieux que j’ai quittés, je fais partie de ce temps qui a passé. Et désormais, dans mon quartier, je peux observer les changements, les passages. J’ai la sensation d’être là. D’appartenir au lieu plutôt qu’au temps. C’est nouveau et très fascinant. Alors j’ai écrit Toto avec effectivement une sorte d’ambition historique, à ma micro-échelle de dix années.
Mais si je dois répondre à la question de ce vers quoi mon écriture naturellement me porte, je ne parlerais pas vraiment d’histoire ni de politique… Ce que je vise avec l’écriture, c’est ce que l’écriture des autres m’a fait quand j’étais seulement lecteur : une vibration particulière, une intensité qui échappe aux catégories, et qui encourage à vivre à la fois pleinement et en retrait. Quand j’écris, je cherche l’ici et l’ailleurs. L’ici du livre qui fait lieu, qui rassemble le corps autour d’un point fixe, et l’ailleurs de l’appel que ce livre contient. Voilà ce que j’aimerais trouver : la clôture et l’ouvert dans la même phrase. Autrement dit : l’un – et l’autre aussi.
J’ai lu sans souci de l’histoire littéraire ni du genre, simplement par passion, parce que ça m’aidait à vivre et à décider de ce que serait ma vie.
Je peux dire que j’ai adoré Nietzsche et Rimbaud, mais surtout qu’ils m’ont été utiles.
Danielle Collobert, ça a été une rencontre fondamentale, comme David Foster Wallace un peu plus tard, dans la même librairie pourtant, qui serait celle où j’allais travailler quelques années plus tard.
Beckett a été un compagnon de lycée, comme Koltès et Vian. Michaux, Rilke et Shakespeare ont assuré la transition.
À un moment j’aimais seulement les poètes du Grand Jeu, Gilbert-Lecomte, Daumal, et Simone Weil par extension.

À la fin des années 90, j’avais décidé de lire des auteurs vivants, et je ne sais pas pourquoi je n’ai presque lu que des femmes. J’avais commencé par Houellebecq il me semble, alors ensuite j’ai lu Despentes, Salvayre, Angot, Nobécourt, Darrieussecq… Laurence Nobécourt est devenue une amie, mais au fond je le savais en la lisant : je savais l’amitié possible. On le sait en lisant les livres, on voit très bien les gens derrière. Ils sont un peu absents mais justement c’est là qu’on les voit le mieux.
J’ai passé beaucoup de temps avec Kafka et Dostoïevski. Mais j’assistais aussi à des lectures publiques et j’aimais beaucoup voir la parole des écrivains passer par leur corps. Christine Angot pour ça, c’était très fort. Édith Azam évidemment. Ce n’était pas du tout une question de performance, mais de présence. Je voyais les écrivains présents à leur écriture. Et la langue leur faisait un corps. La langue les faisait tenir à un endroit du monde.
En vrac, quelques passions : Pizarnik, Jon Fosse, Sony Labou Tansi, Don de Lillo, Lispector, Pasolini, Kleist, Bove, Barthes.
Cet été : Onetti, Obiégly, Vesaas.
Les gens ont l’impression d’être tellement loin du poème. Il y a des murs partout, si on peut en abattre un ou deux de temps en temps, ça ne fait pas de mal.
J’aime énormément les lectures publiques, c’est souvent l’occasion pour moi d’essayer des choses. J’aime bien me trouver debout face à des gens avec un texte que je n’ai jamais lu à personne. Je le lis, et alors je le comprends mieux, je trouve ses défauts plus rapidement, ils me sautent aux yeux. Je rentre chez moi avec du travail. C’est différent des salons où on se trouve face à une table et on attend que la pile diminue.
Les rencontres, c’est autre chose. Depuis quelques mois, je travaille avec une musicienne, Mathilde Braure, que j’ai rencontrée lors du festival Feuilles d’automne à Verniolle, organisé par un libraire flamboyant, Dominique Mourlane du Relais de Poche. On se connaissait déjà mais il a eu la bonne idée de nous associer. Et depuis nous avons proposé une vingtaine de lectures, d’abord dans le cadre du Printemps des Poètes dans un certain nombre de collèges et de lycées, puis grâce à un dispositif de la Drac qui nous a mené de médiathèques en maisons de quartiers.
J’adore lire, et j’aime particulièrement le travail qu’on fait avec Mathilde, qui est un travail d’écoute et d’entente, reposant sur une véritable complicité artistique, mais le plus surprenant, le plus riche, ce sont les réactions des gens après la représentation, ce qu’ils tiennent à nous dire, ce qu’ils veulent à tout prix partager avec nous : d’autres lectures ou des chansons, ou des souvenirs d’enfance, un point de vue sur le monde, un simple étonnement. Pour la plupart, ils ne pensaient pas que la poésie leur ferait quoi que ce soit. Et en fait, non seulement ça leur a parlé, mais en plus ça les fait parler. C’est beau quand on y arrive. Les gens ont l’impression d’être tellement loin du poème. Il y a des murs partout, si on peut en abattre un ou deux de temps en temps, ça ne fait pas de mal.
J’aime lire les textes, mais j’aime aussi lire les images.
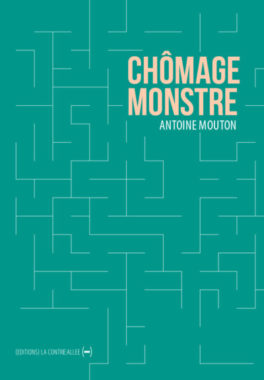
Je ne sais pas très bien quel est mon rapport à la photographie, il change tout le temps. C’est longtemps resté une pratique amateure, presque secrète. Je n’avais strictement aucune ambition de ce côté-là. J’aimais simplement montrer à quelques amis mes photos. Et puis peu à peu j’en ai mis dans des livres, et finalement il y a eu des expositions, alors c’est un secret très mal gardé. Maintenant j’y pense. Quand je prépare un livre, je me demande quelle place pourrait avoir la photographie.
C’est à cause de Benoît Verhille, l’éditeur de la Contre-Allée, que c’est venu. Je lui avais envoyé le manuscrit de Chômage monstre, il voulait l’éditer, mais au dernier moment il m’a dit : “on ne mettrait pas des photos dans ce livre ?” J’ai réfléchi, j’ai pensé en mettre 100 d’un coup, comme si la vanne de tout ce que je retenais de rendre public depuis vingt ans venait de sauter, et finalement j’en ai mis 3. Alors Benoît a accepté les trois photos, mais il m’a dit : “le prochain livre, ça pourrait être des poèmes et des photos à part égale, qu’est-ce que tu en penses ?” Et c’est devenu Poser Problème.
Comme c’est un livre qui se déroule sur une journée, et qui pose la question de comment on la traverse, je me suis imaginé que l’écriture était une jambe et la photographie une autre, et que c’était l’alternance des deux qui me permettait de marcher jusqu’au bout. La photo : manière de faire silence aussi. De faire regard à côté d’un poème. De faire taire ce qui s’est dit. De fondre la lettre dans le décor. Je ne sais pas bien.
En ce moment, je prépare mon propre jeu de tarot avec des photos que j’ai prises. J’aime lire les textes, mais j’aime aussi lire les images.
Un article de Julien Coquet du 22 mai 2022, à retrouver ici :
« Toto perpendiculaire au monde » et « Les Chevals morts » d’Antoine Mouton : Un couloir infini et une séparation
Plein d’inventivité, le troisième roman d’Antoine Mouton séduit par sa folie furieuse et son humour, tandis que les éditions La Contre Allée republient un court texte du même auteur, Les Chevals morts.
Comme vous vous en doutez, nous lisons beaucoup. Et nous écrivons beaucoup sur nos lectures afin de vous recommander la perle ultime. Parfois, nous sommes un peu tristes : tout se ressemble, les schémas narratifs sont vus et revus, l’histoire sans intérêt… et on en vient à douter de la nouveauté en littérature. Et pourtant, pourtant, des livres comme Toto perpendiculaire au monde d’Antoine Mouton redonnent espoir. Cinématographiquement parlant, c’est comme si vous aviez enchaîné les bons films, mais un peu trop classiques, et que vous tombiez sur un Quentin Dupieux ou un Luis Buñuel. La déflagration.
De votre lecture, vous serez constamment surpris. Antoine Mouton invente un monde fou, qui peut, à sa manière, rappeler nos très chers confinements. Unité de lieu pourrait-on dire, le couloir 133 accueille des couples derrière chacune de ses portes. Le couloir, sans fin, sans caractéristique particulière, se présente comme une ligne. De part et d’autre se trouvent donc des couples auxquels une fonction est attribuée (président, policier, sculpteur…). Dans leur chambre minuscule, chaque couple s’adonne à sa tâche sans trop se poser de question. Le quotidien se retrouve seulement perturbé par des lâchers de ballons (« Les ballons nous donnent des repères dans l’espace, un horizon dans l’aplani. Quand nous les apercevons nous savons où aller, que faire de nos corps, de nos vies. »). Toto, le narrateur, partage une chambre avec sa femme, qui refuse de lui dire son nom.
A cela, ajoutez une histoire parallèle, lue par Toto, celle de deux jumeaux, Otto et Hans, dont l’un ressemble à l’autre (la réciproque est fausse). Ces deux histoires, par une belle pirouette vont se croiser, sans que l’on vous en divulgâche le pourquoi du comment. Car Toto est perpendiculaire à son monde, au couloir 133 qu’il n’épouse pas. Conseillé par son ami sculpteur enfermé dans sa propre statue, Toto rêve d’ailleurs et de remonter l’infini du couloir.
On l’aura compris, toute la folie de Toto perpendiculaire au monde grise le lecteur. Après, déjà, les trouvailles d’Imitation de la vie, Antoine Mouton renouvelle son théâtre de l’absurde. Prendre conscience du couloir 133, c’est mieux se questionner sur la vie que nous menons et sur les règles de notre société car, par ajout subtile, l’auteur dérègle sa mécanique, notamment par l’arrivée surprise d’un nouveau couple. Et également par un meurtre qui, tel celui d’Abel par Caïn, ébranle profondément la communauté. Ces personnages sous cloche qui rêvent d’ailleurs, dont seule l’arrivée des ballons constitue un divertissement au sens pascalien, c’est nous. Assez ri, assez pleuré.
Extrait :
« Ici, au 133, on n’a jamais su comment les choses ont commencé. Certains se passionnent pour ce début dont ils ignorent tout, tentant de l’éclairer à la lumière d’hypothèses artificielles qu’ils passent toute leur existence à échafauder ; d’autres préfèrent envisager la fin : j’en fais partie. Quand je lis une petite histoire, si courte soit-elle, je veux aller au bout. Le présent m’échappe, je cours après autre chose que ce qui est. Je suis si pressé d’arriver au terme du récit qu’en le reposant je m’aperçois souvent que je n’en ai rien retenu. Je vis de la même façon, sans savoir ce qui m’arrive, épris seulement de ce qui m’arrivera – mais pourrait-on retenir le présent ? Et si on y parvenait, on en ferait quoi, de tous ces instants suspendus, chloroformés ? On les mettrait dans des boîtes, qu’on ouvrirait pour les curieux, auxquels on dirait : « Voilà ma vie ? » Et alors ? »
En parallèle, les éditions La Contre Allée publient de nouveau un court texte d’Antoine Mouton, Les Chevals Morts, paru initialement en 2013 aux éditions Les Effarées. En un peu plus de trente pages, Antoine Mouton retrace les pensées qui se bousculent dans la tête d’un homme en train de se séparer de sa compagne. Marqué par l’oralité, presque sans ponctuation, Les Chevals morts a été plusieurs fois monté sur scène, et on imagine le souffle de ce flux de conscience qui devait se déverser dans la salle . Le texte, à la limite de la poésie, se présente comme une supplication, « un « ne me quitte pas » contemporain », comme le remarque Patricia Cottron-Daubigné. A la fois prière pour sauvegarder un couple qui se délite, Les Chevals morts est également un hymne à l’amour, à la sensualité et aux émotions qui valent la peine d’être vécues, malgré les « chevals morts » qui se dressent toujours entre deux êtres qui s’aiment (« il y a tellement de chevals morts entre les gens et entre les chemins qu’ils prennent »). La langue d’Antoine Mouton est toujours inventive, pleine de jeux de mots (« les chevals morts ne nous rapatatraperont pas », « les chevals cataclopent mais ne galopent pas »), bref, d’une liberté folle.

Les Chevals morts est dans le Lundi Poésie de Libération du 4 avril 2022. Un article d’Alban Kacher :
« Il est la preuve que les bons romanciers ne font pas toujours de mauvais poètes. Né en 1981, c’est par la porte du récit qu’Antoine Mouton entre, à vingt-trois ans, dans le monde de l’édition. Au Nord tes parents, publié aux éditions La Dragonne, lui vaut le prix des apprentis et lycéens de la région Paca. Par la suite, plutôt que de faire le choix d’un genre particulier, il explore à la fois l’espace du poème et les formes plus narratives, publiant notamment trois romans chez Christian Bourgeois. Il ne se cantonne d’ailleurs pas à la littérature, mais s’intéresse aussi à d’autres formes de création, comme le cinéma, le théâtre ou encore la photo. Après avoir publié deux de ses recueils de poésie en 2020 (Poser problème et Chômage monstre), les éditions de La Contre Allée proposent, début mars 2022, une réédition de son ouvrage sorti en 2013 aux Effarées : Les Chevals morts.
«les chevals morts se nourrissent de nos erreurs
du foin de nos erreurs
de tout ce foin qu’on fait
entre leurs dents avec nos erreurs»
Tout commence par une faute. «Chevals». Mais à force de la répéter, cette faute finit par sembler naturelle. «Chevals» sonne juste. A force d’entendre ce mot on l’intègre à notre lexique. De même qu’à force de se laisser séparer des autres, on voit là quelque chose de naturel, inévitable. C’est l’erreur que font les hommes, l’erreur de la séparation alors qu’il aurait pu en être autrement. Il y a là un ridicule que symbolise bien la faute grammaticale intégrée au titre. Mais ce ridicule ne fait pas rire ; il tue. La mort est l’ennemi, le seul mot comportant une majuscule, tout en majuscules même parfois : «MORT». Comme s’il n’y avait justement que ça de réel, cette force diffuse qui aplanit, écrase tout ; comme si la mort régnait. La mort, chez Antoine Mouton, ce n’est pas la fin de la vie. C’est la vie continuée sans force, sans goût pour cela qui continue malgré tout.
«il y a tellement de gens seuls
dont on dirait qu’ils ont perdu des morceaux d’eux-mêmes
il y a tellement de morceaux de gens qui ne sont plus eux-mêmes
après avoir perdu quelqu’un
je ne voudrais pas, nous, qu’on se perde et qu’on se morcelle
il suffit de bien regarder où nous mènent les chemins qu’on prend il suffit de rester clairvoyants
mais il y a tellement de tristesse à nos trousses tellement de gens qui se séparent tellement de gens dont les chemins s’écartent comme les jambes d’un cheval mort»
Du «ils» au «je», «je» qui est en fait un «nous», qui se bat pour rester un nous. Celui qui s’exprime ici lutte contre les probabilités, contre ce qui arrive d’ordinaire aux gens. Au centre du recueil se trouve le refus de la fatalité, la croyance fondamentale en ce que peuvent les hommes, s’ils ne baissent pas les bras et acceptent de mener cette guerre. Le «je» part en croisade contre la peine, contre toute cette masse de peine qui écrase les hommes autour de lui et menace de l’écraser lui-même, ainsi que la femme qu’il aime.
«nous étions au plus nu au plus défait
même défait l’amour restait
même dépecé par la tristesse
même roué des coups du sort
le sort n’avait rien de mauvais
l’amour faisait de nous des sorciers, des sorciers avec des jambes pour courir sur la lande où les chevals morts mouraient, des sorciers avec des mains pour se tenir serrés»
La misère force à revenir à l’essentiel, aux éléments premiers, au «plus défait». Revenir à une vérité simple, évidente, pour comprendre et ne plus commettre toutes ces fautes qui nourrissent les chevals morts. La langue est simple, elle doit l’être pour dire ce qui doit être dit ici, porter ce lyrisme sobre qui traverse toute l’œuvre d’Antoine Mouton. De même les choix formels tendent vers une esthétique épurée, qui se ramifie au fur et à mesure que le poème avance, mais commence toujours par un propos minimaliste, auquel la voix tente toujours de revenir. Alors que le vers s’allonge peu à peu, on se rapproche de quelque chose qui serait comme le verset d’un Claudel laïque. Claudel qui ouvre Tête d’or par la complainte d’un homme seul, Cébès, dans la lande où un second personnage, Simon, vient enterrer sa compagne. Mais ici, la voix cherche justement à se faire entendre avant que la mort ne gagne. Cherche à dire et faire que «nous ne mourirons pas».
Lire l’article sur le site ici.

Un article de Rodolphe Perez sur Zone critique, le 28 mai 2022.
Antoine Mouton : Il y a des amours heureux
Zone Critique présente aujourd’hui le texte Les Chevals morts d’Antoine Mouton, paru au printemps 2022, aux éditions La Contre Allée. Si le texte ne se présente pas à proprement parler comme un recueil, sa structure hybride, la voix qu’il porte et son élaboration d’une parole singulière, lui donnent une dimension poétique évidente et forte. Défense et illustration de l’amour heureux!
Chant d’amour
Chant amoureux, conjuration du désespoir, déconstruction des topiques tristes de l’amour, le texte de Mouton vient colmater les plaies d’un discours amoureux hanté par la peur de sa propre fin et engage à vivre avec une énergie lumineuse les intermittences du coeur.
Les Chevals morts s’organise autour d’une parole au rythme puissant, qui embarque avec elle le lecteur dans un hymne à l’espoir. Chant amoureux, conjuration du désespoir, déconstruction des topiques tristes de l’amour, le texte de Mouton vient colmater les plaies d’un discours amoureux hanté par la peur de sa propre fin et engage à vivre avec une énergie lumineuse les intermittences du coeur. Le projet de l’écriture est d’emblée posé : « je ne voudrais pas que nos chemins se séparent je ne voudrais pas, non, qu’ils se séparent »
Car en effet « il y a tellement de gens seuls
dont on dirait qu’ils ont perdu des morceaux d’eux-mêmes
il y a tellement de morceaux de gens qui ne sont plus eux-mêmes »
Là toute la beauté du texte de Mouton : une course à la parole pour lutter contre le défaitisme amoureux, contre le cancer de la déréliction. Après tout, pourquoi n’y aurait-il pas d’amours heureux ? « je ne voudrais, nous, qu’on se perde et qu’on se morcelle ». Avant le « il est déjà trop tard » d’Aragon, c’est un amour du soi contre soi, car « les corps, oui, ont ce pouvoir que n’ont pas les chemins de se défaire l’un de l’autre en restant épris l’un de l’autre ».
L’amour dont parle Antoine Mouton est un rempart et non une chute. Les mots s’opposent à la collapsologie ambiante, à l’amoncellement des chevals morts, ces accidents du réel, ces pièges du vécu universel. Et après ? « mais il y a tellement de tristesse à nos trousses tellement de gens qui se séparent tellement de gens dont les chemins s’écartent comme les jambes d’un cheval mort ». Alors le poète tisse les mots, retrace le lien, non pas un lien qui aurait disparu mais un lien qui s’invisibilise, qui s’étouffe sous les corps entassés des chevals morts : c’est toujours faire jaillir les fleurs du mal et cracher à la face du cynisme qui prétend à la fatalité de l’étiolement :
« les chevals morts prennent peu à peu les prénoms de ceux qu’ils ont aimés, ils prennent toutes les caresses et tout l’amour et ils broient cet amour entre leurs dents qui tombent, la tristesse aime tant qu’on la prenne pour l’amour ».
C’est bien à contre-pied que s’élève la parole d’Antoine Mouton, dans une précipitation essoufflée qui bataille contre ce qui sépare et la distance, une parole qui frappe par sa conscience d’une tristesse qui gangrène au fil du temps :
« la tristesse de l’inadvertance
et tous ces coeurs disjoints qui cataclopent dans des directions contraires
avec parfois la certitude de se retrouver
et parfois pas
parfois l’écueil, l’écartèlement, la disjonction des chemins contraires à l’amour à la joie à la folie d’être ensemble »
Aux amants victorieux
Car nul n’ignore les ravages de la tristesse, le galop interminable du désespoir du monde et comme il enferme, détourne et vicie les beautés du geste inaugural d’aimer : « les gens qui étaient ensemble se retrouvent seuls et leurs visages sont séparés de quelque chose qu’on ne voit pas
quelque chose qui n’est plus là quelque chose qui avait un prénom un visage une peau une voix »
Et la mélancolie sur l’amour impose son pessimisme et son regard sombre, voile longtemps et sans crier gare le lustre promis d’une chaleur amoureuse. Alors, manuel de survie à l’usage des amoureux qui refusent l’obsolescence programmée de ce qui toujours est pourri au royaume du Danemark, le texte frappe, invite et ouvre :
« les chevals morts il disent
pourquoi aimer toujours la même personne ?
ils disent
tu pourrais aimer quelqu’un d’autre
mais c’est de la tristesse ça »
C’est qu’il faudrait toujours entendre la voix qui vous murmure à l’oreille une invitation à la douceur et à l’audace de l’optimisme, contre l’hégémonie de la peur. Voilà le chemin superbe et heureux qu’ouvre le poète, après le constat d’une méfiance qui nous assiège, pour mieux lui opposer les chemins de l’union émue : « les chevals sont derrière tu entends il ne faut pas en avoir peur ils ne nous dépasseront jamais pas pas pas nous cataclopent galopent pas ils essaient seulement de s’immiscer ». Au gré d’une parole qui emporte dans sa danse et prête à rêver avec, Mouton rappelle aux amants de « tirer la langue jusqu’à ce qu’elle devienne notre chemin », d’ignorer l’interminable discours du refus d’un abandon à l’autre :
« ils disent
l’amour aliène
et ils tiennent le registre de tes blessures, un, deux, trois, quatre, cinq cents millions de blessures, tu peux compter sur eux, ils te dénombrent
ils te font croire aussi que l’être est seul »
Brisant d’un même geste le procès en sentimentalisme, l’auteur offre un texte d’une incroyable justesse, d’une fantaisie pleine de joie, ode à la dualité et à l’amour, à la rencontre : « nous sommes si libres que nous nous aimons nous attacher ne nous fera pas peur pas pas pas nous ». Là où l’intimité de s’aimer, avant le risque de se perdre, et celui de se trouver. Là où tuer la mort et lui opposer l’énergie interminable de vivre à la gaieté du verbe aimer, et enfin « que la chaleur de ton cul soit la chose la plus précieuse au monde ».

Les Chevals morts d’Antoine Mouton dans l’émission Paludes de Nikola Delescluse du vendredi 13 mai 2022. À écouter (et réécouter) juste en dessous !
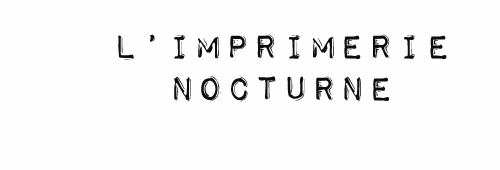
Après Stig Dagerman, Souad Labizze et Kae Tempest, nous poursuivons nos propositions de lecture format court en compagnie cette fois-ci d’un texte haletant, Les chevals morts d’Antoine Mouton. C’est un truc très beau qui contient tout*.
« je ne voudrais pas, nous, qu’on se perde et qu’on se morcelle
il suffit de bien regarder où nous mènent les chemins qu’on prend il suffit de rester clairvoyants
mais il y a tellement de tristesse à nos trousses tellement de gens qu se séparent tellement de gens dont les chemins s’écartent comme les jambes d’un cheval mort
il y a tellement de chevals morts entre les gens et entre les chemins qu’ils prennent »
C’est un texte qui ne s’arrête pas, une cavalcade en cataclop sans point, retour à la ligne
ça ne s’arrête pas dans l’écriture fulgurante d’Antoine Mouton, ça ne s’arrête pas pour ne surtout pas se retourner sur Les Chevals morts, ceux qui se nourrissent de la tristesse, des lambeaux d’histoire et de la mort, ça va vite et c’est sublime dans la vitesse et la détermination de ne pas se laisser rattraper
il y a l’amour, il y a le sexe dans des landes de plaisir, alors ça fonce entre les lignes d’une poésie sans majuscules mais qui dit pourtant tout haut des choses très belles, des choses très fortes, des qui bouleversent, des qui renversent, attention à la tristesse, ne te retourne pas, avance à la phrase suivante, pour ne pas séparer les chemins
« il n’y pas de faute il n’y a que des erreurs et nous ne mourirons pas car nous sommes attentifs les chevals morts ne nous rapatatraperont pas »
c’est une course entre les mots et les images, pour éviter ces chevals morts, une course qui semble sans respiration alors que l’écriture d’Antoine Mouton en donne beaucoup, de l’air, du vent, et des étreintes, avec quelques embûches syntaxiques, comme pour tomber et mieux se relever, encore, encore, loin des chevals morts
bien loin des chevals morts.
*Pour reprendre le titre d’un recueil de lettres de Neal Cassady paru aux Éditions Finitude.
Ce poème en prose, d’un seul souffle, au titre enfantin qui lui donne la force et l’endurance du premier âge, est vraiment très beau. C’est une ode à l’amour qui doit être superbe à entendre. Ce texte a déjà été mis en scène plusieurs fois.
Découvrez le reste de la chronique en suivant ce lien.