
Revue Phoenix
Un article de Charles Jacquier, publié dans le numéro 38/2022 de la revue Phoenix :

Un article de Charles Jacquier, publié dans le numéro 38/2022 de la revue Phoenix :


C’est une maison distinguée , un « établissement (qui) compte parmi « ce qu’il y a de mieux à Madrid » ». Dans les vitrines impeccables, gâteaux, petits pains, brioches, chocolats et meringues promettent des pauses sucrées à la clientèle, sous l’oeil obséquieux et servile de « la responsable» derrière sa caisse enregistreuse. Défilé ininterrompu d’amateurs de douceurs, des premières heures du jour jusque très tard dans la nuit : on y croise une population éminemment hétérogène, domestiques, employés, coursiers, vieilles bigotes et dames distinguées, jeunes gloutons et retrai tés gourmands, dont les vagues se suivent mais ne se confondent pas. Et l’on y distingue, « se découp(a)nt sur le plan ocre du mur du fond », les silhouettes sans visage des petites mains, blouses noires (et) cols amidonnés » assurant le service, remplissant les bouteilles de lait, nettoyant les plateaux. Une ruche vrombissante, devant et derrière le comptoir, mais qui fait corps « en apparence seulement » : ici deux mondes irréconciliables s’affrontent, profondément divisés, irréductiblement cloisonnés, que régulent une froide logique comptable et une sourde mécanique de domination. Le premier, doux et lumineux, agréablement parfumé. L’autre, sale et obscur. Dans ce salon de thé madrilène du début des années 1930, sous les poses distinguées et l’atmosphère policée, les vitrines alléchantes et incessamment briquées peinent à masquer la cuisine insalubre, le réduit sombre et humide où les employées, chaque matin, accrochent leurs vêtements à de pauvres clous avant d’enfiler leur uniforme: « Ici, vous n’êtes pas des femmes; ici, vous n’êtes que des vendeuses. » (…) Rien de plus qu’un appendice du salon, un appendice humain très utile ».
Et passent les journées, interminables, gestes automatiques enchaînés sans pause -nettoyer les tiroirs, dépoussiérer les bonbonnières, découper, compter, remplir, compter encore. Des journées rongées par des sursauts protestataires bien vite étouffés par la crainte de perdre son emploi, passées à vendre des plaisirs que l’on serait bien en mal de se payer, et avalées la faim au ventre – une « faim (qui) ne date pas de quelques heures ni de plusieurs années, (…) une faim de toute une vie, ressentie depuis plusieurs générations d’ancêtres misérables ». Pour ce non moins misérable bilan : « Dix heures, fatigue, trois pesetas. » Et, parfois, quelques miettes de brioche rassie prudemment dé robées, petites souris grignotant en douce les chocolats quand « la responsable consomme son copieux repas ».
Un salon de thé comme un raccourci : dans ce microcosme pâtissier, où le super-flu jouxte sans ciller les besoins les plus primaires, c’est bien toute la société espagnole d’avant la guerre civile dont Luisa Carnés trace le portrait. Mettant à profit son expérience personnelle, cette oubliée de la Génération de 27 (Lorca et consorts), exilée comme beaucoup dès 1939 au Mexique pour fuir le régime franquiste, raconte au plus près la réalité concrète des travailleurs, peinant à joindre les deux bouts dans une économie dévastée par la crise de 29. Mais elle évoque surtout la condition des femmes dans cette société figée, écrasée par le conservatisme politique et religieux. Condition terrible, que la plupart acceptent comme une fatalité, ployant sous un système qui ne leur laisse que cette pauvre alternative: « choisir le foyer, par l’intermédiaire du mariage, ou l’usine, l’atelier et le bureau. L’obligation de contribuer à vie au plaisir de l’autre, ou la soumission absolue au patron ou au supérieur immédiat. D’une façon ou d’une autre, l’humiliation, la soumission au mari ou au maitre spoliateur ».
Membre du Parti communiste espagnol, fervente défenseuse de la cause républicaine, Carnés décrit sans juger les stratégies de survie des unes et des autres. Simplicité de la langue, multiplicité des sensations, descriptions minutieuses, dessinent peu à peu les contours d’un collectif fragile. Placent au centre de ce récit choral et très organique le corps des femmes, au croisement d’oppressions multiples et séculaires : corps voué à la séduction, avant d’être abimé, avachi, utilisé, blessé. Conspuant l’emprise de la religion, qui atrophie les cerveaux », Carnés clame le rôle fondamental de la culture pour libérer les esprits féminins des réves sucrés et convenus que l’on s’acharne à leur servir. Et appelle de ses voeux le jour où nous, les pauvres, on cessera d’avoir faim et les pieds trempés en hiver », quand la rue devant le salon bruisse d’appels à la grève, sur fond d’inexorable montée des fascismes en Europe. Daté, vraiment ?
Article source à lire en ligne par ici

Les femmes au temps du prolétariat
Un ouvrage inédit en français de Luisa Carnés. Écrit dans les années 30 en Espagne. Renversant !
Rédigé entre août 1932 et février 1933, publié une première fois en espagnol en 1934, puis réédité en 2016, voici que paraît, traduit en français par Michelle Ortuno, sous le titre Tea Rooms (femmes ouvrières), un récit pour le moins effarant. On le doit aux (Éditions) La Contre Allée et plus particulièrement à sa collection “La Sentinelle”, dont la raison d’être est de porter “une attention particulière aux histoires et parcours singuliers de gens, lieux, mouvements sociaux et culturels”. Et quel parcours singulier que
celui de Luisa Carnés (1905-1964) ! Née dans une famille d’ouvriers, elle commence à travailler à 11 ans. Elle aurait pu subir ; pourtant, elle va réagir. Sans aucune instruction, elle décide d’apprendre par ellemême. Elle lit énormément et s’intéresse au monde dans lequel elle vit. Après avoir écrit des nouvelles pour la presse, elle publie un premier roman, Natacha, avant de se consacrer à l’écriture d’un romanreportage, Tea Rooms, fruit de son expérience professionnelle dans un salon de thé. Survivre plutôt que vivre On ne pousse la porte de ce qui est aussi une pâtisserie qu’après une trentaine de pages, le temps pour Luisa Carnés de contextualiser le milieu social dans lequel vit – survit serait plus exact – Matilde, celle à travers les yeux desquels la lectrice, comme le lecteur, va être invitée à scruter les employés, les patrons, les clients – a priori un monde assez clos – tout en entendant aussi les grondements qui s’élèvent dans la rue, dans Madrid et au-delà – l’Espagne des années 30 est un pays en proie à nombre de soulèvements.
Société divisée
Matilde a divisé mentalement la société en deux : “d’un côté ceux qui prennent l’ascenseur et de l’autre ceux qui passent par l’escalier de service”. C’est à partir de cette façon d’appréhender le monde que se déploie le récit. Un point de vue marxiste, avec les dominants et les dominés, les employés et les chefs, voire même, pour un lieu riche en pâtisserie, les gens qui s’empiffrent et ceux qui n’ont même pas “une pomme de terre et une arête de morue”. Des employés exploités, dont la fin de la journée se résume à : “dix heures, fatigue, trois pesetas”. Le style de Luisa Carnés est sec, son propos sans concession est acéré – si théâtral aussi qu’on souhaiterait le voir porté à la
scène. Esperanza, Antonia, Truri, Para, Laurita, Marta : si les collègues de Matilde cherchent une place, une reconnaissance dans une société où l’émancipation passe encore par le mariage, elles ne sont pas toutes aussi rebelles qu’elle qui défend “la solidarité, l’union des travailleurs. Sans l’unité dans l’action, on n’arrive à rien”. “Avant, on croyait que la femme ne servait qu’à prier et à repriser les chaussettes de son mari, déclare une syndicaliste lors d’une assemblée; maintenant, on sait que la femme vaut autant que l’homme pour la vie politique et sociale.” Hier et aujourd’hui : deux mondes, deux époques et, pourtant, un parallèle particulièrement troublant
Madrid, années 1930, Puerta del Sol. À quelques hectomètres du kilomètre zéro, un tea room accueille la fine fleur de la bourgeoisie madrilène : industriels, intellectuels, artistes.
Derrière le comptoir s’affairent Antonia, Laurita, Paca, Matilde, Marta. Sous le regard malveillant et les brimades de « la responsable », elles se démènent pour un salaire qui leur laisse à peine de quoi vivre. Mais justement, que vivre quand tous les désirs sont cadenassés, inféodés aux injonctions d’une société classiste et machiste ?
En dépit des difficultés, Matilde ne se laisse pas faire et ne rate jamais une opportunité de dire sa façon de penser. À travers ses yeux, le ballet incessant qui anime le tea room nous est rendu dans sa luxuriance et sa cruauté. Une écriture documentaire au service d’une fresque sociale, mais sans le côté chiant et donneur de leçons. C’est vivant, haletant, léger et tragique. Et alors si vous aimez comme moi les mille-feuilles de meringue saupoudrés de sucre impalpable, ce livre est pour vous.
Alexis Alvarez Barbosa
Écrivain, musicien et professeur de langue espagnol
Article source ici

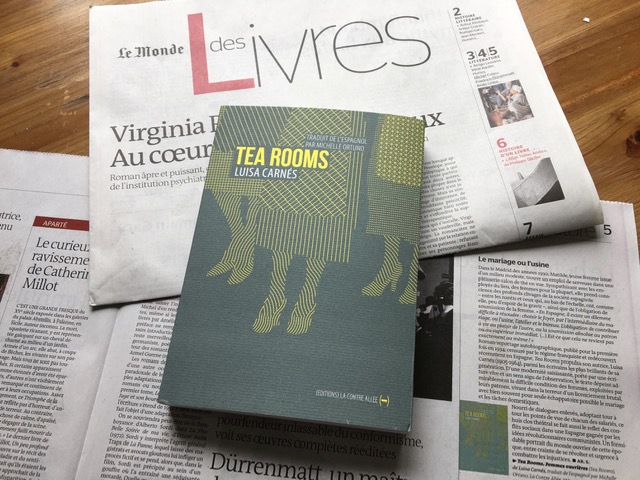
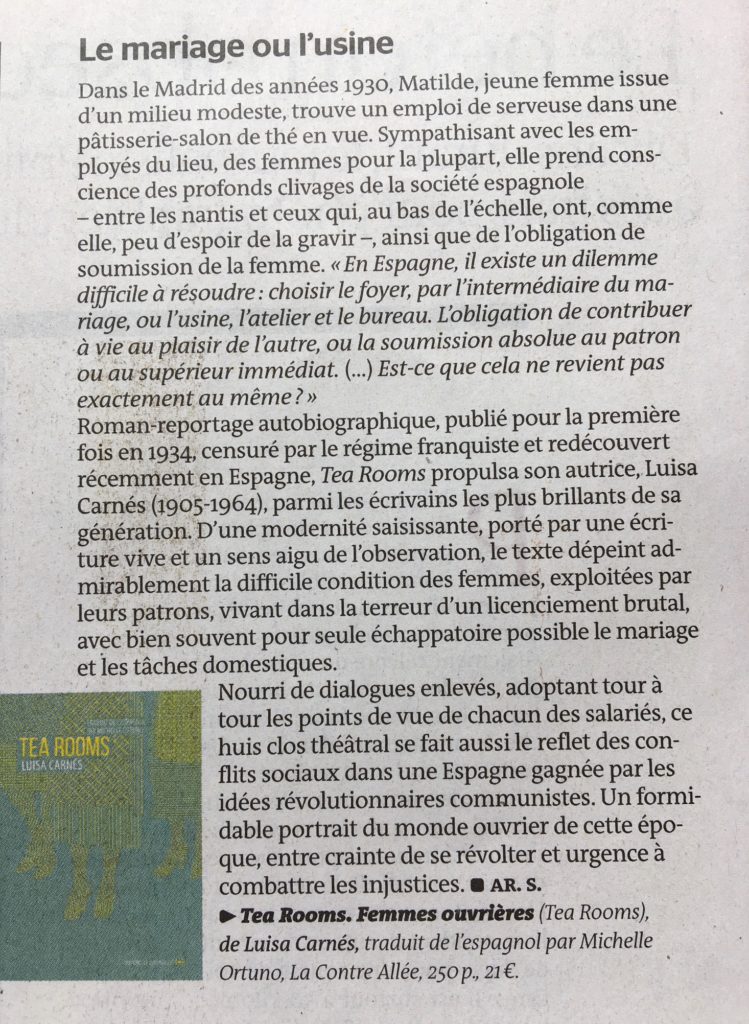
Contrairement à celle de ses contemporains hommes, la voix de Luisa Carnés est restée longtemps dans l’ombre. Cette journaliste et autrice autodidacte est née dans une famille pauvre et a dû commencer à travailler très jeune. Elle s’est notamment engagée pour le Parti communiste et a été exilée au Mexique, où elle finira sa vie.
Sa condition de femme, ajoutée à celle d’ouvrière et à ses idées politiques, a participé à son oubli malheureux dans la période d’avant-guerre.
Tea Rooms, écrit en 1934, est aussi bien une fiction qu’un roman témoin de sa propre expérience d’employée et de femme précaire. Il s’agit également d’un constat historique sur l’Espagne prolétaire de cette époque, où les luttes ouvrières grondent et où le Front populaire n’existe pas encore.
” Dans les pays capitalistes, et en particulier en Espagne, il existe un dilemme, un dilemme difficile à résoudre : choisir le foyer, par l’intermédiaire du mariage, ou l’usine, l’atelier et le bureau. L’obligation de contribuer à vie au plaisir de l’autre, ou la soumission absolue au patron ou au supérieur immédiat. D’une façon ou d’une autre, l’humiliation, la soumission au mari ou au maître spoliateur.
Est-ce que cela ne revient pas exactement au même ? “
Comme des centaines d’autres femmes et hommes, Mathilde bat le pavé madrilène des années trente à la recherche d’un emploi. Ses vêtements élimés et son ventre creux lui rappellent à tel point il est vital de décrocher un poste, pour sa survie comme pour celle de sa famille. Mais dans les files de postulantes, il y a tellement d’autres filles plus belles et mieux apprêtées qu’elle, des qui « présentent mieux »… Après un énième refus, elle décroche finalement un poste dans un salon de thé de renom, véritable miniaturisation de la société capitaliste. En effet, ici c’est comme partout : il y a l’échelle sociale et ses barreaux d’injustices humaines, le gouffre entre les prolétaires et les bourgeois·es… Le tout sous fond de porcelaine et d’effluves de gâteaux rances.
Dehors, dans les rues, une colère bouillonne : celle des laissé·es pour compte, des crèvent la faim, des victimes de la crise économique. Les employé·es ont le choix : soit ils et elles restent à leurs postes et serrent les dents, soit ils et elles prennent part à cette lutte pour leurs droits et perdent leur précaire (mais précieux) emploi.
Luisa Carnés brosse le portait de différentes femmes, chacune ayant un rôle bien précis dans ce théâtre qu’est leur lieu de travail. Mathilde est pour l’émancipation et l’indépendance féminine, ne souhaitant pas se marier ni s’encombrer d’un homme sous prétexte d’assurer ses arrières. L’Ogre, sa supérieure, se soucie bien peu des conditions de travail de ses paires et semble même endosser avec plaisir un rôle tyrannique. D’autres encore sont rongées par l’ignorance ou encore plongées dans la religion. Mais au final, même une bonne situation ne les protège pas de l’étau du patriarcat, comme le démontrera le sort de la filleule du patron.
” Mathilde écoute sans intervenir. Bien sûr. L’exploité possède un ventre et aussi, en plus, un corps susceptible d’avoir froid et d’avoir chaud, et qu’il est nécessaire de couvrir, selon ses moyens économiques. Et quand on n’a pas de moyen, on cherche la manière d’en obtenir, de quelque façon que ce soit.
Les propriétaires de commerces devraient tout faire, et ce dans leur propre intérêt, pour que le ventre de leurs vendeuses soit toujours plein et leurs pieds bien chaussés. ”
Dans Tea Rooms, les tensions sont partout : À la maison, où la pauvreté grignote tout. Dans le pays, où des mouvements se soulèvent. Au travail, où les inégalités règnent et où personne n’est à l’abri du licenciement (sans parler des conditions mêmes : dix heures de labeur pour une poignée de pesetas). De toute part, on s’applique à rappeler aux plus démuni·es à quel point ils et elles n’ont pas accès à la dignité et à la tranquillité.
L’autrice y traite donc des violences ordinaires, égrenées par petites touches insidieuses. Le salon de thé est le parfait microcosme des inégalités engendrées par les rouages du capitalisme : les mieux loti·es viennent s’y prélasser et se faire servir par des petites mains anonymes.
Ainsi, la pauvreté affamée côtoie quotidiennement l’opulence et l’insouciance des ventres pleins, tandis que les supérieur·es préfèrent jeter les restes ou les laisser aux souris.
Ouvrage sociologique mordant et intraitable, Tea Rooms décrit une exploitation toujours courante et même banalisée. Bien qu’écrit il y a presque cent ans, la précarité, et les injustices qui y sont narrées par Luisa Carnés sont toutes aussi cuisantes de nos jours. Un roman toujours très actuel, porté par une écriture moderne et engagée.
“Ces proverbe lui ont appris qu’elle ne possédait rien d’autre sur terre que ses larmes, et c’est pourquoi elle en verse sans compter.”
Luisa Carnés faisait partie de la Generación del 27, groupe littéraire espagnol aux idées avant-gardistes dont l’histoire n’a retenu que les noms masculins (1). Publié pour la première fois en 1934 dans la catégorie « roman-reportage », Tea Rooms : Mujeres obreras, inspiré de son expérience de vendeuse, tomba vite dans l’oubli en Espagne tandis que, fuyant le fascisme, elle s’exila au Mexique où elle continua son travail de journaliste et d’écrivaine jusqu’à sa mort accidentelle en 1964.
L’oeuvre de l’auteure (2) fut néanmoins récemment remise à l’honneur dans son pays d’adoption où elle fit l’objet d’une thèse, Tea Rooms étant même republié avec un minuscule tirage pour le cinquantième anniversaire de sa mort, selon le désir de ses héritiers (3). Ce fut à cette occasion qu’un critique littéraire s’enthousiasma pour ce récit novateur ayant valeur de témoignage historique et convainquit l’éditeur Hoja de Lata de le publier de nouveau en Espagne en 2016 – où il rencontra un gros succès critique et public.
Et dans cette première traduction française de Tea Rooms, Femmes ouvrières, Michelle Ortuno nous fait réentendre la voix de cette exilée communiste et féministe longtemps oubliée dans son propre pays.
1) https://fr.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9n%C3%A9ration_de_27
2) Elle a laissé un corpus littéraire d’une douzaine de romans, une soixantaine de nouvelles, trois cents pièces de théâtre et des centaines de chroniques.
3) https://www.hojadelata.net/el-regreso-de-luisa-carnes/
Le roman se passe en 1930 dans une Madrid en pleine crise économique où les classes populaires s’enfoncent dans la misère. Et au travers de son héroïne lectrice de «livres révolutionnaires», il s’adresse à toutes ces femmes qui n’ont comme culture que des «romans à l’eau de rose» et qui «continuent à cultiver la religion» les rendant fatalistes ou à «rêver d’un hypothétique mari». Mais aussi à celles qui pourraient s’émanciper grâce à la culture et «se moquent complètement de leur émancipation car elles n’ont jamais porté de souliers usés, jamais connu la faim qui engendre les rebelles» (4).
Après de vaines recherches, la jeune Matilde trouve enfin un emploi précaire de vendeuse dans un salon de thé – pâtisserie : un microcosme élégant baignant dans des odeurs suaves où, sous la surveillance de la responsable et du propriétaire baptisé « l’ogre », s’active toute une galerie de pauvres femmes et filles exploitées et résignées de peur de perdre leur travail. Mais dehors les syndicats s’organisent et la lutte des classes commence à faire rage. Et Matilde, qui ne pense pas que «parler par derrière» fasse avancer les choses, veut croire en l’avènement d’un monde nouveau. Même si son expérience de l’humiliation et de la souffrance l’a amenée à une définition concrète de la société avec «d’un côté ceux qui prennent l’ascenseur et de l’autre ceux qui passent par l’escalier de service».
4) Notamment au travers du personnage de Laurita, la filleule du propriétaire
Ecrit entre août 1932 et février 1933 par une militante, ce roman social engagé fournissant de nombreux détails précis et concrets (5) frappe par sa modernité. S’éloignant d’un naturalisme trop pesant tout en atténuant sa teneur idéologique indéniable, il est en effet raconté au présent avec une étonnante vivacité et légèreté par un narrateur extérieur épousant d’abord le point de vue individuel de Matilde, fine observatrice à la conscience politique en éveil, pour ensuite embrasser cette collectivité souvent futile à dominante féminine, passant tour à tour d’une protagoniste à l’autre. Et, surtout, il s’avère d’une facture plus théâtrale et cinématographique que romanesque.
5) La description des vieilles cabines téléphoniques faisant office de vestiaires, le comptage des heures de travail, le nombre exact de pesetas du salaire, le nombre et le prix des brioches …
Tea Rooms est ainsi divisé en une succession de vingt-deux petites scènes alternant descriptions et dialogues qui se se déroulent, dès la quatrième, dans une sorte de huis-clos. Pour parler de la condition ouvrière féminine et des luttes sociales, Luisa Carnés se concentre en effet habilement sur la vitrine trompeuse de ce salon de thé de bonne réputation.
Confinées dès le matin, les employées y «suspendent leur personnalité», laissant dehors leur vie de misère en troquant leur robe rapiécée contre la blouse noire uniforme et le sourire de façade, tandis qu’entrent et sortent des clients des plus hétérogènes et des livreurs. Et dans cet espace scénique limité mais plein de vie se révèle indirectement, au travers de ce constant va-et-vient, des conversations tronquées et des petits incidents scandant la routine des journées, les espaces qui lui sont extérieurs : ceux des familles populaires aux dures conditions d’existence et de toute la société espagnole gagnée par l’agitation sociale et politique. Un huis clos dans lequel se joue le triste destin de femmes victimes de cette société patriarcale et religieuse qui, faute d’éducation et acculées par la pauvreté, se voient enfermer dans des dilemmes : soumission à un mari ou à un patron, «maître spoliateur», domesticité conjugale ou prostitution…
La narration, juxtaposant des phrases souvent courtes, s’apparente souvent à un scénario, auquel s’ajoutent les réflexions et les commentaires aiguisés et imagés de Matilde témoignant de sa prise de conscience politique. L’oeil du narrateur, véritable caméra, livre des images marquantes comme ces employées chosifiées, femmes-troncs derrière leur comptoir : «les blouses noires, les cols amidonnées, se découpent sur le plan ocre du mur du fond». Ou saisit en un instant la jeune employée dérobant une pièce ou l’incursion d’un homme travesti : «Une personne se dirige vers le comptoir des pâtisseries. Elle porte une toilette légère de soie souple, à larges motifs de chrysanthèmes jaunes et bleus. Ses pieds, trop grands. Ses coudes, trop pointus, sombres et froncés. Les muscles de son cou extrêmement marqués. Une allure étrange.»
Et nombre de plans captent en plongée le dessous des choses, grossissant des détails signifiants comme ces chaussures qui vous trahissent ou ces employées mangeant en cachette sous le comptoir.
En nous racontant le quotidien d’un salon de thé madrilène d’un regard acéré et en se faufilant dans les conversations de tout ce petit monde, Luisa Carnés brosse une critique implacable du capitalisme. Elle espérait manifestement être entendue au travers de la voix de sa jeune héroïne fière de sa liberté annonçant la «femme nouvelle» et appelant à «la lutte consciente pour l’émancipation prolétaire internationale». Une émancipation ne pouvant à ses yeux passer que par la révolution car, selon son voisin au chômage connaissant beaucoup de choses sur le sujet, «il existe un pays ou les ouvriers n’ont pas faim».
Et si dans sa forme ce roman datant de près d’un siècle n’a pas pris une ride, son propos illustre, lui, une époque bien dépassée où tous les espoirs semblaient encore permis.

JUNE 09, 2021
Dans Tea Rooms, l’écrivaine et journaliste communiste observe les inégalités et la montée de la colère sociale dans le Madrid des années 1930.
C’est un roman documentaire d’une étonnante modernité, le récit d’une prise de conscience individuelle et de l’émancipation collective des femmes espagnoles dans les années 1930. À Madrid, la jeune Matilde se présente sans grand espoir à un test pour décrocher un poste de mécanographe. Dehors, se presse une cohorte de femmes de tous âges, attirées par la même petite annonce. En rentrant dans le logement qu’elle partage avec sa mère et ses frères et sœurs, Matilde s’offusque de la lettre d’un soi-disant employeur qui lui réclame une photographie, pensant profiter de sa crédulité et de sa détresse. « Tu ne vois pas que ce M. F. international cherche une fille pour tout ? » rétorque-t-elle à sa mère, qui l’encourage à accepter. Après des recherches infructueuses, elle trouvera un emploi dans un salon de thé-pâtisserie, une ruche où s’affairent de nombreuses employées sous le regard sévère de la responsable, gardienne de la division des tâches et d’une stricte hiérarchie.
Depuis cet observatoire privilégié, Matilde détaille le ballet des clients alléchés par les beignets et les tartelettes, écoute les conversations de ses collègues, aiguise son regard critique sur les inégalités sociales. « La vendeuse, dans son uniforme, n’est rien de plus qu’un appendice du salon, un appendice humain très utile », relève Matilde, esquissant de brefs portraits des employées. Il y a Esperanza, 50 ans, la femme de ménage « sale, bourrue et grossière », veuve d’un militaire qui s’est pendu ; Laurita, la filleule du patron, dont les formes rondes cachent un drame ; Marta, petite souris maigre qui vole des brioches qu’elle mange en cachette dans les toilettes et finira par être mise à la porte pour avoir caché une peseta dans sa culotte. Cet univers feutré, où les clients viennent autant pour se montrer que pour le réconfort procuré par la crème et du sucre, n’est pourtant pas à l’abri des bruits du dehors. Alors que gronde la révolte des ouvriers et syndicalistes, des voix de femmes s’élèvent pour réclamer l’égalité, l’accès à l’éducation, le droit d’avoir un autre avenir que le mariage ou la prostitution.
Écrit entre 1932 et 1933, Tea Rooms (femmes ouvrières) est le livre le plus connu de Luisa Carnés, romancière et journaliste autodidacte, membre du Parti communiste espagnol. Née en 1905, elle a été ouvrière dès l’âge de 11 ans et a travaillé dans un salon de thé qui lui a donné la matière de cet étonnant roman-reportage. En raison de ses engagements politiques pendant la guerre civile, elle a dû s’exiler au Mexique, où elle est morte en 1964. Invisibilisée par la censure franquiste, elle est aujourd’hui reconnue comme une voix qui compte dans l’histoire littéraire espagnole. Grâce aux éditions la Contre Allée, les lecteurs français découvrent aujourd’hui son talent, ses combats et sa saine colère.

Retrouvez l’avis audio de Manon pour France Bleu ici

SIBILLA Aleramo a 30 ans quand paraît Une femme (1), son autobiographie romancée, en 1906. Elle n’avait jamais écrit auparavant; elle n’avait jamais imaginé qu’elle deviendrait une figure importante de la littérature italienne de la première moitié du XXe siècle, et l’une des premières voix du féminisme dans son pays. Même bourgeoise, même évoluant dans un monde favorisé, elle était, comme tant d’autres, programmée pour la procréation et l’obéissance. Dans Une femme, elle raconte comment elle a quitté le Piémont pour accompagner son père qui partait diriger une usine dans le centre du pays, puis a épousé l’un des cadres de l’entreprise, qui l’a dominée, trompée, méprisée. En donnant forme à ses émotions et à ses réflexions sur le papier, elle apprend à se défendre – elle quitte époux et enfant – et à affûter une plume de journaliste, puis d’écrivaine. «Pauvre vie, mesquine et aveugle, à laquelle on tenait tant!, écrit-elle. Tout le monde s’en accommodait : mon mari, le docteur, mon père, les socialistes et les prêtres, les jeunes filles chastes et les prostituées; chacun tenait à son mensonge avec résignation.» Dans ce livre charnière, qui connut immédiatement un grand succès et fut l’un des quatre premiers ouvrages publiés en France par les éditions Des femmes en 1974, ce ne sont pas les propos militants qui touchent le plus aujourd’hui, mais l’introspection brûlante qui traverse des moments d’égarement avant d’atteindre à la clarté de la révolte. Luisa Carnés, elle, vient du prolétariat espagnol et arrive sur le marché du travail en 1916. Elle est ouvrière à 11 ans et travaille longtemps dans le textile. C’est avec un récit-roman sur un milieu social découvert à la faveur d’un nouvel emploi qu’elle met en lumière la condition d’autres femmes : Tea Rooms (2), en 1934. L’action se passe presque exclusivement dans un salon de thé de Madrid. Les riches y mangent des pâtisseries. Des acteurs y paradent en espérant jouer bientôt dans les films parlants. Les serveuses sont sous surveillance; elles ne gagnent pas assez d’argent pour prendre le tramway et se font parfois séduire par des clients qui ne seront plus là quand il faudra affronter le drame des avortements clandestins. Là aussi, la parole politique paraît inutile face à la richesse des scènes piquetées à coups d’épingle, où tendresse et fureur sont délicatement voilées. Dans ces mêmes années, la donne est différente en Argentine pour Silvina Ocampo, qui, dans Inventions du souvenir (3), retrace à sa manière le tohu-bohu de son enfance (le livre, établi à partir de plusieurs états d’un manuscrit entamé en 1960, n’a paru qu’en 1987). Issue d’une famille très fortunée, elle sera l’épouse de l’écrivain Adolfo Bioy Casares et une amie de Jorge Luis Borges. Avec ce poème narratif qu’elle appelle plaisamment une «histoire prénatale», elle va jusqu’à l’adolescence dans un mouvement burlesque gonflé de férocité et de sexualité. C’est un doux jeu de massacre de la pensée des adultes rangés, sur fond d’attention portée aux mendiants et aux domestiques. Anne Picard a traduit avec d’habiles mots rares cette raffinée Zazie de Buenos Aires. Postsurréaliste, ce style insolent illustre l’humour du «presque rien», qui sera plus tard celui d’un Copi, et qui concourt à la fabrication d’une belle dynamite verbale.
GILLES COSTAZ.
Il y a près de vingt ans, assis à la table d’un célèbre salon de thé madrilène, j’observais les clients, les serveuses, les churros trempés dans le chocolat chaud. Je pris une photo sépia. Cette image m’est subitement revenue en mémoire en lisant l’ouvrage de Luisa Carnés, Tea Rooms. Petit bijou littéraire ressurgi du passé – merci à ces éditeurs intrépides, chercheurs de trésors – le livre de cette ouvrière espagnole autodidacte décrit à merveille une Espagne pré-républicaine au bord du gouffre de la guerre civile avec ses codes et ses injustices.
Véritable chronique sociale, écrit dans un style alerte, sec, ne laissant que peu de respiration au lecteur, Tea Rooms raconte, à travers Mathilde, le quotidien des employés d’un salon de thé. Tirée de sa propre expérience, Luisa Carnes nous dépeint avec ironie et férocité, les rapports de pouvoir, les petites mesquineries quotidiennes qui régissent ce salon de thé mais également, à travers lui, cette société espagnole des années 30 où se croisent ouvriers, militaires, acteurs en vogue et dévots. Il y a dans ces pages le déclassement des unes, la survie des autres et les rêves brisées de toutes. A travers les yeux de ces gens qui doivent travailler pour survivre, de ces invisibles d’une autre époque, l’auteur déploie une analyse à la fois sociologique, comportementaliste, anthropologique et politique. Il y a celles qui construisent leurs personnages, celles qui souhaitent fuir leurs conditions, celles qui s’avilissent devant l’autorité et celles enfin qui usent de faux-semblants pour ne pas disparaître. La modernité du texte saute immédiatement aux yeux avec cette exploitation des plus pauvres et ces femmes-objets réduites à leur physique. Toute l’humanité est là. Et au milieu, cette fracture, cette « ligne de partage » entre riches et pauvres. « Bien qu’on ne sache pas encore la définir avec des mots, on la voit, on la sent à tout moment » écrit Luisa Carnés. Comme un séisme, cette ligne de partage plongera, quelques années plus tard, l’Espagne dans le chaos. Et les rêves brisés de quelques-uns deviendront les cauchemars de tous.
Par Laurent Pfaadt
Article source ici

Aujourd’hui, on sait gré à La Contre Allée de sortir de l’oubli -pour le public francophone- Luisa Carnés. Travailleuse dès l’enfance, autodidacte et membre de la Génération de 27 (groupe littéraire auquel appartenaient notamment Federico García Lorca et Pedro Salinas), elle se fera une place parmi les grands dans les années 30, avant de voir ses engagements pendant la guerre civile et la censure sous Franco la dissoudre dans l’Histoire. En 1934, elle tire de sa propre expérience ce roman, Tea Rooms. À Madrid, nous suivons Matilde, jeune chômeuse. Engagée dans un établissement où s’agitent d’autres employées rôdées et résignées dans leurs gestes, elle observe d’un oeil circonspect une responsable assez intraitable et un patron qu’on surnomme l’ogre. On abolit les jours de relâche, et on licencie l’une d’entre elles, signe que » d’un côté il y a ceux qui prennent l’ascenseur et de l’autre ceux qui passent par l’escalier de service ». Une grève naissante va les questionner toutes. La promptitude de l’héroïne à penser hors du cadre, l’oeil aiguisé et l’élégance avec lesquels Luisa Carnés décrypte ce microcosme où les odeurs de biscuits se mêlent au parfum sulfureux des liaisons illégitimes en font une lecture déjà enthousiasmante. Quant à l’émergence d’une lutte prolétaire parmi les employées ou aux pensées révolutionnaires de l’autrice, elles sont bien davantage qu’une simple cerise sur le gâteau: elles sont la preuve vibrante que déjà à l’époque, certaines femmes trouvaient intolérable d’avoir à choisir entre la soumission à leur mari et celle à leur patron.
Article source ici
Tea Rooms a été écrit par une autrice espagnole qui puise son écriture et ses sujets dans sa propre vie. Luisa Carnés (1905-1964) est née dans une famille ouvrière et a commencé à travailler à l’âge de onze ans comme apprentie dans un atelier de chapellerie, elle travailla également dans un salon de thé. Autodidacte, elle s’est passionnée pour la littérature par la lecture (les feuilletons dans la presse populaire puis les romans russes notamment). Elle a commencé à écrire, d’abord dans des journaux.
Un roman espagnol de 1932-33, avant-gardiste
Le roman, publié en 1934, a apporté la consécration à son autrice et lui a permis de devenir journaliste à temps plein. Membre du PCE stalinien, elle avait défendu le droit de vote des femmes. Pendant la guerre civile (1936-39), elle se consacre à du théâtre engagé, « de défense » du camp républicain, avec Rafael Alberti, écrivain de la Generación del 27 (Génération de 27), un groupe littéraire de poètes avant-gardistes auquel appartient aussi Garcia Lorca. Lors de la victoire de Franco, elle passe en France avant d’accepter l’offre du président mexicain Cardénas et de s’exiler en 1939 au Mexique, avec d’autres intellectuels espagnols, où elle écrit dans la presse, notamment celle du PCE en exil. Elle meurt en 1964, dans un accident de voiture.
Après avoir écrit dix romans, trois pièces de théâtre et des centaines de chroniques, Luisa Carnés est tombée dans l’oubli… à l’image d’autres écrivaines espagnoles de son époque. À cause de la censure de la période franquiste, de l’exil, du fait qu’elle se réclamait du féminisme et du communisme, probablement. Un exemple de l’invisibilité des femmes dans la littérature comme dans les arts. Des maisons d’édition espagnoles s’attachent aujourd’hui à rééditer des œuvres ainsi oubliées. Tea Rooms est paru en 2016 en Espagne et sa traduction française vient de sortir. Un autre de ses romans, Natacha, a été publié en Espagne en 2019.
Tea Rooms, une expérience de travail dans un salon de thé
Nous sommes donc à Madrid, au début des années 1930, la République vient d’être mise en place et la crise économique sévit. Matilde, la jeune héroïne du roman, cherche du travail comme dactylo pour faire vivre sa famille qui est dans une grande misère et n’a souvent à manger qu’un vieux morceau de fromage. Les seules propositions émanent de patrons demandant une photo… Elle finit par être embauchée dans un grand salon de thé, qui sent bon ! Elle y côtoie des serveurs, des employées, une femme de ménage, tous travaillant dix heures par jour pour un salaire dérisoire.
Il y a Antonia, ancienne dans la maison, gentille et attentionnée, mais résignée à l’exploitation ; Paca, grenouille de bénitier qui passe son temps libre dans un couvent ; Marta, toute jeune fille à la situation familiale difficile et qui a fui un travail où un des vendeurs la poursuivait de ses assiduités ; Laurita, la nièce du patron, « l’ogre » (surnom donné par les employés) ; Faziello, le vendeur de glace italien qui vit au rythme des lettres de son fils, antifasciste régulièrement emprisonné ; la responsable, toujours désignée ainsi, une peau de vache. Et, bien sûr, Matilde, qui observe tout : le contraste entre l’apparence chic et respectable du salon de thé et la réalité des gâteaux « spéciaux » du jour, fabriqués à partir de restes plus ou moins frais. Certains rendez-vous amoureux sont de la prostitution déguisée.
Matilde est révoltée et sa conscience politique s’éveille, entre autres grâce à des discussions avec un voisin : « Je veux dire par là que la fin des patrons et de tous les capitalistes est proche ; et que nous, les pauvres, on cessera d’avoir faim et les pieds trempés en hiver […] Déjà, il existe un pays où les ouvriers n’ont plus faim. […] Ce pays s’appelle la Russie. » Certaines formulations ont un parfum de « réalisme socialiste », et rappellent les liens de l’autrice avec le Parti communiste espagnol, stalinien s’il en fut, dont la politique allait contribuer à étouffer la révolution espagnole.
Le roman n’en montre pas moins la condition des femmes, source de révolte pour Matilde : « Dans les pays capitalistes, et en particulier en Espagne, il existe un dilemme, un dilemme difficile à résoudre : choisir le foyer, par l’intermédiaire du mariage, ou l’usine, l’atelier et le bureau. L’obligation de contribuer à vie au plaisir de l’autre, ou la soumission absolue au patron ou supérieur immédiat. D’une façon ou d’une autre, l’humiliation, la soumission au mari ou au maitre spoliateur. » La situation sociale est présente aussi, et vient régulièrement perturber le quotidien du salon de thé : heurts entre manifestants et police, grève de serveurs et d’employés de café qui tentent de débaucher les travailleurs du salon de thé.
La chronique sociale est juste et intéressante, les personnages attachants et complexes. Le bouillonnement politique de l’Espagne du début des années 1930 est sous nos yeux, comme le poids de la religion, l’hypocrisie qu’elle fait régner, et l’éveil de bien des consciences.
Liliane Lafargue
Dans le Madrid des années 30, Matilde tente désespérément de trouver du travail. Après de nombreux entretiens, elle finit par se faire embaucher comme vendeuse dans un salon de thé. Elle y croise d’autres jeunes femmes, des serveurs qui, comme elle, viennent de milieux défavorisés et dont les familles subsistent grâce à eux. Entre peur du chômage et conditions de travail contestables, Matilde prend conscience de l’oppression subie par les ouvriers dans la société espagnole.
« Tea rooms » a été publié en 1934, Luisa Carnés était elle-même ouvrière et engagée notamment au parti communiste. Autodidacte, elle devint journaliste et écrivaine. L’auteure commença à travailler à l’âge de onze ans dans l’atelier de chapellerie de ses tantes. Mais elle travailla également dans un salon de thé et son roman est proche du reportage.
Dans un style très moderne et concis, Luisa Carnés nous offre des descriptions extrêmement minutieuses du travail dans ce salon de thé mais également du caractère de chaque vendeuse (elle est plutôt dure sur leurs physiques !). Le monde dans lequel évolue ces ouvrières est totalement chaotique : la crise de 29 est passée par là et la 2nd guerre mondiale est proche. La condition des femmes à cette époque est vraiment au cœur du livre. Les ouvrières sont encore moins considérées que les ouvriers, elles sont totalement invisibles. « Les hommes qui passent dans le salon regardent à peine la vendeuse. La vendeuse, dans son uniforme, n’est rien de plus qu’un appendice du salon, un appendice humain très utile. Rien d’autre. » Et cet emploi n’empêche pas la misère, l’une des vendeuses vole pour pouvoir s’offrir de nouvelles chaussures ou des trajets en tramway pour rentrer chez elle. Mais Luisa Carnés n’arrête pas son analyse de la condition des femmes au salon de thé. Elle nous montre également que l’oppression existe aussi dans la sphère privée avec le poids de la religion et des traditions. Luisa Carnés n’hésite d’ailleurs pas à parler d’avortement.
Le monde, qui voit évoluer Matilde, est celui où montent le fascisme (un vendeur de glace italien fait le récit de ce qui se passe en Italie grâce aux lettres de son fils) et le communisme. Ce dernier est encore source d’espoir et de possible rébellion. Matilde, double de l’auteure, s’éveille à la politique, prend conscience dans ce salon de thé du sort réservé aux plus pauvres. Elle croit au communisme, à la solidarité entre travailleurs comme Luisa Carnés elle-même. Nous savons que l’Histoire leur donnera tort.
Roman social et politique, « Tea rooms » nous montre avec justesse et minutie le sort des ouvrières dans le Madrid des années 30. Luisa Carnés nourrit son livre de ses propres expériences, de ses propres combats et on ne peut que remercier les éditions de la Contre Allée de l’avoir sortie de l’oubli et de nous faire découvrir le talent de cette auteure espagnole.
Étrange destin que celui de Luisa Carnés : née en 1905 dans une famille modeste, elle commence à travailler dès onze ans dans l’atelier de modiste de sa tante. Passionnée de lecture, elle dévore les grands romanciers russes, mais aussi Cervantès et Victor Hugo. Après avoir exercé différents métiers, dont celui de serveuse dans un salon de thé, elle s’essaie à l’écriture et publie son premier livre, un recueil de nouvelles, en 1928. Son premier roman, Natacha, paraît en 1930, mais c’est avec Tea Rooms (1934) qu’elle s’impose définitivement comme une des meilleures romancières de sa génération. Militante communiste, journaliste engagée, elle est contrainte à l’exil par la victoire de Franco. Après un bref passage par la France, elle s’installe à Mexico, où elle décède en 1964 dans un accident de la circulation.
Pendant ses années d’exil elle ne cesse d’écrire, mais en Espagne son œuvre est occultée par la censure franquiste et elle tombe petit à petit dans l’oubli. Il faudra attendre 2017 et 2018, avec la réédition de Tea Rooms et la publication de ses nouvelles complètes, pour qu’on la redécouvre enfin.
Tea Rooms paraît aujourd’hui en français, et l’excellente traduction de Michelle Ortuno nous permet de découvrir un texte d’une étonnante modernité.
Jeune Madrilène pauvre, Matilde cherche du travail et finit par se faire embaucher dans un salon de thé. Dotée d’un sens aigu de l’observation, elle regarde et écoute, et nous voyons se dérouler le ballet des employés et des clients. Il y a là Antonia, la plus ancienne des serveuses, qui trime depuis des années pour un salaire de misère. Il y a Paca la dévote, Felisa la frivole, Marta, qui se fait renvoyer pour avoir volé dans la caisse, Pietro, le glacier italien dont le fils croupit dans les geôles de Mussolini, et la jeune et naïve Laurita, qui mourra à la suite d’un avortement clandestin. Sur ce petit monde règne la responsable du salon, elle-même sous les ordres de l’Ogre, le grand patron qui vient chaque semaine distribuer les maigres salaires.
Pendant la journée, et jusque tard dans la soirée, les clients se succèdent. Ce sont d’abord les bonnes du quartier, qui viennent chercher du lait et du pain. Puis c’est l’heure des dactylos, des employés de bureau, des garçons de magasin. Arrivent ensuite les maîtresses de maison, qui achètent leurs flans et leur crème chantilly. L’après-midi, ce sont les couples de fiancés, les jeunes filles prenant le goûter, les retraités s’offrant un petit gâteau. Et le soir il y a la clientèle des spectacles et les bandes d’acteurs. Luisa Carnés fait défiler tout un condensé de la population madrilène, où les classes sociales se croisent, mais ne se mélangent pas.
Du dehors parviennent les échos de l’agitation politique qui marque les débuts de la Seconde République espagnole : nous sommes en 1932, et les grèves et les manifestations se multiplient.
En choisissant ce microcosme du salon de thé comme scène de son roman, Luisa Carnés parvient de manière très efficace à mettre en lumière les différentes facettes de la condition féminine. Elle nous propose une analyse passionnante des oppressions de genre et de classe, dans une approche qu’on qualifierait aujourd’hui d’intersectionnelle. Son écriture sèche et nerveuse, avec ses nombreux effets de montage, doit beaucoup à l’esthétique cinématographique, mais fait aussi penser à certains écrivains d’avant-garde des années trente, comme John Dos Passos. Elle est parfaitement rendue par le remarquable travail de Michelle Ortuno.
Terje Sinding
Article source ici

Tea Rooms est un texte très fort. Publié en 1934, il raconte le quotidien d’un salon de thé à Madrid. Loin d’être simplement un roman social illustrant la vie des salariés alors que la crise économique se fait plus gravement sentir, le récit met en scène avec précision les clients et employés qui fréquentent ce commerce dans lequel Mathilde parvient à se faire embaucher.
Alors que le chômage monte et que le travail se fait rare, la misère règne dans les quartiers modestes de la capitale espagnole. Il s’agit bien plus de survivre et de nourrir sa famille que de gagner de quoi vivre décemment dans les rues de Madrid. Les gérants et directeurs des entreprises et commerces font partie des gens aisés et n’hésitent pas à profiter de leur position privilégiée pour exploiter leur personnel. Luisa Carnés en fait un portrait sans concession ; le propriétaire du salon de thé est surnommé « l’ogre » par ses employés. L’homme qui reçoit Mathilde en entretien pour un travail de bureau est gros et chauve et « une salive brune perle aux commissures de ses lèvres. ». L’autorité des responsables et leurs exigences sont difficiles à supporter. Les vendeuses travaillent dans des conditions sociales précaires ; leurs jours de congés sont souvent susceptibles d’être supprimés. Leurs heures de présence sont nombreuses avec peu de pauses ; elles sont fatiguées et ont sans cesse mal aux pieds.
La situation économique dans la ville est telle qu’une partie de la population est contrainte d’accepter des emplois inférieurs à ses compétences ; Mathilde cessera de postuler comme mécanographe pour être embauchée comme vendeuse dans un salon de thé. Outre le fait de toucher un salaire moindre que ce qu’elle aurait pu décemment gagner, l’obtention de ce poste se teinte d’une sensation d’échec, le sentiment d’être sous-estimée, de ne pas réussir à faire valoir ses aptitudes réelles.
Alors que les mouvements de grève se multiplient, que les ouvriers se syndiquent et se retrouvent pour protester contre des conditions de travail et une exploitation abusive, Mathilde et ses collègues s’inquiètent de ce mouvement qui gronde dans les rues de la ville ignorant comment réagir, sachant à quel point elles sont susceptibles d’être renvoyées à tout moment.
Le roman montre l’envers du décor du salon de thé, « une maison distinguée » de Madrid comme la responsable de l’établissement le caractérise. Aux pâtisseries fraiches et au service impeccable exigé des serveurs s’oppose le local sale et puant dans lequel se changent les jeunes-femmes ainsi que la présence de souris qui s’aventurent jusque sous les comptoirs. Entre Esperanza la doyenne qui a plus de cinquante ans et Felica, qui n’a que dix-huit ans, Trini, Clara, Laurita et Marta, les histoires de chacune concourent à faire un portrait hétérogène des femmes qui travaillent avec Mathilde.
Luisa Carnés est né à Madrid en 1905 dans une famille modeste. Elle a commencé à travailler à onze ans. Tea Rooms est inspiré de sa propre expérience dans un salon de thé où elle a été employée. Autodidacte, elle réussit à devenir journaliste et romancière. Obligée de s’exiler au Mexique en raison de son engagement au parti communiste, pays où elle décèdera en 1964, elle a été oubliée dans son pays où elle avait été saluée néanmoins comme l’une des meilleures écrivaines de sa génération. Redécouverte et rééditée en Espagne, ce sont les éditions de la Contre Allée, en France, qui de la traduire et de la faire connaitre.

Madrid, années 30. Matilde, jeune femme banalement pauvre, trouve une place de vendeuse dans un salon de thé. Une rude routine s’installe. Chaque jour, «dix heures, fatigue, trois pesetas», sous les yeux «balayant tout» de la responsable et la pression du propriétaire, «l’ogre». Soixante-cinq heures par semaine, avec ses collègues, prêtes à trimer comme elle pour des clopinettes, sans sourciller ou presque. Car «l’ouvrière espagnole continue à cultiver la religion et à rêver de ce qu’elle appelle sa » carrière » : un hypothétique mari». Mais Matilde est «l’une de ces rares et précieuses insoumises, capables de renier cet héritage commun». En elle sommeille «la femme nouvelle». Achevé en 1933, Tea Rooms est un roman initiatique prolo-féministe drôlement avant-gardiste : il y est déjà question de charge mentale, de harcèlement, d’avortement, de grève… Bref, de résistance à «la soumission au mari ou au maître spoliateur». Luisa Carnés, longtemps censurée par le régime de Franco, mérite d’être relue. «Nous savons maintenant que les pleurs et les prières ne mènent à rien. Les larmes provoquent des migraines et la religion nous abrutit.» A.I.-A.
Article source ici
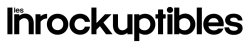
De la condition de la femme, en Espagne, en 1934. Roman collectif détaillé comme le témoignage animé de cette indispensable colère, de cette haute confiance en un bouleversement politique seul à même de changer la ligne de partage entre riches et pauvres. Luisa Carnés, voix injustement oublié, signe un très fort texte sur la responsabilité sociale de l’exploitation, de la misère qui particulièrement frappe les femmes. Tea rooms ou le nécessaire rappel de l’inacceptable, toléré quand on est affamé.
Il est des livres dont l’urgence historique ressort comme un indispensable rappel allant bien au-delà de sa valeur de témoignage. Évitons bien sûr les rapprochements hasardeux : en 1934, l’Espagne, comme une grande partie de l’Europe, est dans une situation pré-insurectionnelle. Crise économique, chômage de masse, fracture ouverte d’une société qui ne forme (si tant que ce fut déjà le cas) un seul corps. Si Tea Rooms évoque quand même notre époque, c’est surtout je crois par sa triste résignation, comme s’il nous était tout à fait impossible de rêver à soulèvement prolétaire, comme s’il nous fallait composer sans fin avec l’échec de celles passées. Difficile néanmoins de ne pas accorder un espoir, un peu trop distanciée certes, à l’énoncé d’une des dernières phrases du roman : « Ce nouveau chemin, à travers la misère et le chaos actuels, est celui de la lutte consciente pour l’émancipation prolétaire internationale. »
Dans les pays capitalistes, et en particulier en Espagne, il existe un dilemme, un dilemme difficile à résoudre : choisir le foyer par l’intermédiaire du mariage, ou l’usine, l’atelier, le bureau. L’obligation de contribuer à vie au plaisir de l’autre, ou la soumission absolue au patron ou au supérieur immédiat. D’une façon ou d’une autre, l’humiliation, la soumission au mari ou au maître spoliateur.
On l’entend, le vocabulaire est celui de toute une époque. La forme choisie par Luisa Carnés sera celle de toute une avant-garde de cette époque. On pense souvent à Manathan Transfert de John Dos Passos : dans sa fièvre populaire, Tea Rooms s’essaye au collage, parvient à restituer une atmosphère collective par des sommes d’impressions, des brusques changements de point de vue, une quasi-absence de personnage principale. On pourrait le dire ainsi : il s’agit de restituer en permanence une tension entre l’individuel et le collectif, l’expérience personnelle doit référer à une structure. Alors, certes, Tea Rooms est très engagé, n’échappe pas toujours aux travers du roman à thèse. Il convient pourtant de souligner de quelle manière l’autrice articule assez brillamment l’indéniable responsabilité sociale dans chacun des faits décrits. Chaque personnage n’est pas entièrement un archétype mais toutes incarnent leur rôle dans la société et la manière dont elles tentent de s’en émanciper.
Elle adhère peut-être à la thèse qui dit que la seule noblesse qui existe sur la planète c’est celle que constitue la caste des opprimés, et elle est fière d’en faire partie.
Saturé de phrases nominales, de lapidaires impressions, le début du roman décrit la recherche désespérée d’un travail. La réalité corporelle de cette lutte des classes. Le printemps c’est pour les riches, pour celles qui n’ont pas honte de leurs chaussures éculées, l’emploi c’est pour les belles jeunes femmes, pas pour les souffreteuses ou rachitiques. La misère n’est pas morale, Luisa Carnés le souligne : le ventre est amoral. Elle ne signe dès lors pas un roman de réalisme socialiste. Matilde se fait engager dans un salon de thé. Il y règne exploitation et humiliation, délégation du pouvoir, crainte du renvoi, molle acceptation des horribles conditions de travail. On pense d’ailleurs à Raymond Guérin et son roman (son titre ne me revient pas) où il décrit les conditions de travail d’un maître d’hôtel. Au fond, ce qui paraît intéressé l’autrice c’est la ligne de fracture où les corps sociaux se révèlent irréconciliables. Un salon de thé, le demi-luxe, sa prétention et ses magouilles pour le profit : on ira pas donner des gâteaux faisandés. L’Ogre, le patron est horrible mais il délègue son exploitation, vient refiler sa nécessaire obole appelée salaire. On impose des supérieurs immédiats, la responsable qui se charge d’incarner, de prendre pour elle, toute la crainte et la peur que doit subir le travailleur. Lumpen prolétariat, force de réserve qu’on exploite jusqu’au bout. Avec une ombre de pessimisme, Luisa Carnés fait de ses femmes un moyen de décrire toutes les manières d’émancipations offertes, pour ainsi dire, aux femmes. Secours sans issus de la religion, du vol, de la prostitution, de l’amour qui conduit à un meurtrier avortement. Bien sûr, reste l’espoir des grèves, la tension du moment est cette sensation d’en être exclue par la peur de perdre son travail. Tea room un vrai roman social et politique, sans complaisance. Soulignons quand même à quel point ses revendications féministes sont des appels encore d’actualité, hélas.
Article source ici
Luisa Carnés (1905-1964) m’était complètement inconnue et il faut vraiment remercier la petite maison d’édition espagnole Hoja de lata établie à Gijón qui, en 2016, a décidé de republier l’un de ses romans, « Tea-rooms-Mujeres obreras » initialement paru en 1934. Il faut également remercier La Contre Allée, qui nous emmène toujours plus loin sur ses chemins de traverse, de nous en donner maintenant la version française.
Ce roman est une perle rare et Luisa Carnés une femme au parcours exceptionnel. Contemporaine de la fameuse Génération de 27 qui comptait en ses rangs, FG Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, Dámaso Alonso, Vicente Aleixandre, Jorge Guillen,… elle aurait dû être sur la fameuse photo des Sin sombrero, ces artistes féministes qui ont accompagné ces grands poètes. Elle aurait dû, mais elle n’était pas de leur monde et on l’a oubliée. Née dans une famille pauvre, elle a travaillé dès l’âge de onze ans et notamment, à un moment de sa vie, dans un salon de thé. Autodidacte, militante communiste et féministe, elle doit s’exiler quand éclate la guerre civile. Passée par l‘un des camps de réfugiés du sud de la France, elle embarque avec d’autres intellectuels républicains sur le fameux transatlantique Veendam, affrété par le président mexicain Lázaro Cardenas. Elle vivra et écrira au Mexique jusqu’à sa mort, accidentelle, en 1964.
Dans « Tea Rooms », elle nous emmène dans un de ces salons de thé chics des années 30 en plein centre de Madrid qu’on imagine très bien avec de grandes vitre style art-déco, des cuivres bien brillants, des serveuses en noir et blanc, un univers feutré où rien ne dépasse. Un lieu qui a le charme désuet des photos sépias ou des films en noir et blanc mais qui a aussi des coins moins reluisants, l’arrière cuisine où se préparent les gâteaux, le réduit où le personnel essentiellement féminin se change, ce personnel qui fait partie du décor : « La vendeuse, dans son uniforme, n’est rien de plus qu’un appendice du salon, un appendice humain très utile. Rien d’autre » (p.41)
Parmi elles il y a Antonia, la plus ancienne, qui est veuve mais doit le cacher car « l‘ogre », le patron, « n’admet pas de femmes mariées dans son établissement ». Il y a Paca avec « son visage pâle et son petit air humble de bigote », Felisa, « joyeuse et frivole », Marta, la petite qui semble fière de faire partie de « la caste des opprimés », Esperanza, la femme de ménage et Laurita, la filleule du patron qui rêve du prince charmant.
Et puis il y a Matilde, jeune et lucide, qui a « une longue expérience de l’humiliation et de la souffrance » et sait très bien depuis l’enfance que la société est divisée en deux : « ceux qui utilisent l’ascenseur ou l’escalier principal et les autres, ceux de l’escalier de service ». Et elle sait qu’elle fait partie « de la seconde moitié » (p.28).
Et c’est à travers le regard de Matilde que nous découvrons cet univers. La responsable, sorte de garde chiourme, « l’ogre », le patron, qui vient chaque semaine pour distribuer les maigres salaires. Il y a les clients qui selon les heures et les jours ne sont pas les mêmes et sont le miroir de la société de l’époque. Il y a aussi l’ambiance qui règne à Madrid, les ouvriers qui se syndiquent, les grèves qui s’organisent, l’espoir d’un monde meilleur.
Tout cela nous le voyons à travers les yeux de Matilde qui elle aussi rêve d’un monde meilleur où la femme pourra prendre en main son destin, qui croit en la nécessité de la lutte collective et de la solidarité mais qui sait aussi que le chemin sera long et difficile : « En Espagne, il existe un dilemme, un dilemme difficile à résoudre : choisir le foyer, par l’intermédiaire du mariage, ou l’usine, l’atelier et le bureau. L’obligation de contribuer à vie au plaisir de l’autre, ou la soumission absolue au patron ou au supérieur immédiat. D’une façon ou d’une autre, l’humiliation, la soumission au mari ou au maître spoliateur. Est-ce que cela ne revient pas exactement au même ? » (p.153-154).
Et « Matilde regarde à travers la vitrine, au-delà de la grande rue goudronnée ; au-delà du somptueux cinéma ; au-delà de l’espace bleu de l’infini, bien au-delà ». (p191).
Elle rêve d’une femme nouvelle, une femme libre qui prendra son destin en main et se demande à la toute fin du livre : « Quand sa voix sera-telle entendue ? ».
Luisa Carnés est comme Mathilde, combattante mais lucide. Elle a su, à travers une parole forte et une écriture limpide, précise, témoigner de l’état d’une société et des rêves qui l’habitaient. Une belle et émouvante découverte.
Françoise Jarrousse
Article source ici
