
Revue de presse
← Un père étranger

Entretien avec Alain Nicolas pour L’humanité
Eduardo Berti: « Mon père et Conrad, fantômes en miroir »
Un écrivain imagine une histoire à partir d’un épisode de la vie de l’auteur d’Au coeur des ténèbres. Dans Un père étranger, le romancier argentin, membre de l’Oulipo, entrelace à foison la création littéraire et l’autobiographie. Entretien.
Eduardo Berti donne avec Un père étranger un livre très différent de ce qu’on connaissait de lui. Membre de l’Oulipo (1), il avait depuis longtemps habitué ses lecteurs à des livres teintés d’humour, subtilement composés, obéissant souvent à des contraintes précises. Avec ce roman, né d’une découverte familiale, il infléchit sa course dans un sens plus grave, plus autobiographique, sans perdre le sourire.
Un père étranger est le premier de vos livre à tonalité autobiographique. Pourquoi cette évolution ?
E.B: Depuis longtemps, j’avais envie d’écrire un livre sur mon père. J’ai découvert qu’il avait laissé six cahiers avec le brouillon d’un roman, et bien d’autres. Mais je n’avais jamais employé la première personne. Sauf une fois, dans la bouche d’une narratrice chinoise… Puis je suis tombé sur la traduction d’un livre de Jessie Conrad. Dans ce livre, écrit du vivant de son mari, elle raconte sa vie aux côtés du grand écrivain. Elle n’avait jusque là publié qu’un livre de recettes de cuisine, préfacé par Joseph Conrad. J’ai été frappé par une scène de leur voyage de noces en Bretagne. Frappé d’une forte fièvre, il s’est mis à délirer dans une langue inconnue, qu’elle pensait être du polonais. J’ai entrepris d’écrire quele chose à partir de ça, sans al moindre idée de ce que ça allait donner. J’ai compris que la situation de JEssie et de Joseph Conrad était très proche de celle de mes parents. Ma mère aussi avait un mari étranger, qui avait rebâti une vie, changé de nom, changé de langue, de métier.
Le livre entrecroise les deux destins de manière différente. Il y a deux romans, et un roman dans chaque roman.
E. B: Le narrateur s’appelle Eduardo Berti. Il décide d’écrire un roman sur la vie de la famille de Joseph Conrad, à Pent Farm, dans le Kent, ce petit paradis des écrivains, pas loin de la maison de H. G. Wells, de celle d’Henry James. Il imagine qu’un lecteur frappe à la porte et dit à Jessie qu’il s’est reconnu dans le personnage d’une des nouvelles de Conrad, qu’il n’aime pas le portrait qu’il a fait de lui et qu’il veut le tuer. C’est ce roman que l’écrivain Eduardo Berti veut écrire. Il y a le récit de la visite d’Eduardo Berti à Pent Farm, de ses recherches. Et c’est là que le fantôme de son père se superpose à celui de Conrad, et que les deux histoires se mêlent.
Cela relève de la tradition de la littérature réfléchissant sur elle-même.
E. B: Oui, mais elle est plus rarement mêlée à de l’autobiographie. Trois choses m’intéressaient. L’aller-retour entre les coulisses du roman et le roman lui-même. Et le mélange de ce travail du travail avec des éléments plus émotionnels. La troisième chose, qui tient aux deux autres, c’est de faire de la palce au roman que mon père, lui aussi, essayait d’écrire. Il n’avait pas de plan, c’est une sorte de chaos. Mais j’y ai pris une histoire qui se déroule en Roumanie, le pays natal de mon père, et qui parle d’eau et de transport. Je voulais « écrire avec mon père », habiter un peu son texte.
Pourquoi avoir choisi Conrad, peu représentatif de cette littérature « autoconsciente », voire revendiqué par ceux qui trouvent le roman ronctemporain trop intellectuel ?
E. B: Cette image est vraie dans ses romans d’action, « maritime » si l’on veut. Mais il y a un Conrad qui se rapproche beaucoup d’Henry James, où l’on trouve une discrète réflexion sur l’art du récit. On y apporte souvent des récits déjà racontés, le cœur de l’action est imaginé, mensonger ou lointain. Mais on le présente plutôt en conteur qui ne se pose pas de question. Le Conrad du livre dit qu’il a vécu trois vies, une comme Polonais, l’autre comme marin, presque comme Français, une troisième où il se réinvente en écrivain anglais. Ce personnage qui dit qu’il va le tuer est peut-être un fou, peut-être quelqu’un surgi du passé. Ma mère et moi avons vécu la même chose avec les secrets et les révélations de mon père. Mais ce roman n’est pas une enquête, il laisse sa place au doute.
Vous êtes membres de l’Oulipo. Cela influe-t-il sur la structure formelle du livre ?
E. B: On ne se présente pas à l’Oulipo. Si on m’a proposé d’en faire partie, c’est qu’on trouvait que mo travail s’en rapprochait. On m’a dit qu’en particulier un roman, Madame Wakefield (Grasset, 2000), où je réécrivais un roman de Walter Scott au féminin, et avec une série de contraintes et de règles, les intéressait. Certains de mes livres sont clairement oulipiens, d’autres pas du tout. Ce qui est intéressant, c’est qu’on n’est pas obligé de faire de l’ « oulipisme ». Un père étranger n’est pas oulipien à mon avis. Mais le suivant, dont une partie va prochainement paraître en France sous le titre Demain s’annonce plus calme, est explicitement oulipien. « Le père étranger » est un cas assez courant dans les romans oulipiens. Mis à part la Vie mode d’emploi ou la Disparition de Perec, la contrainte sous sa forme la plus rigoureuse est présente dans des textes courts, nouvelles, contes, poèmes. Un père étranger n’est pas un livre à « cahier des charges », mais il y a des éléments oulipiens, comme l’arborescence des fins possibles, le rôle de la répétition comme « démarreur ». Le potentiel de la structure comme forme narrative fait partie des réflexions de l’Oulipo. Moi, je peux me lancer à l’aveugle, mais je n’arrive pas à poursuivre si je ne vois aps clairement au moins al persepctive d’une structure. Et ce que j’aime aussi dans la tradition de l’Oulipo, c’est l’humour, l’autodérision.
Vous avez écrit un livre en français. Quel est votre rapport aux langues et à la traduction ?
E. B: Conrad a écrit dans une langue qu’il a choisie. Mon père n’a pas écrit en roumain. Je viens d’un pays où l’immigration est énorme, où l’étranger n’est pas si rare que ça. La plupart de mes amis ont des grands-parents étrangers, surtout italiens. Nous avons ue langue fantôme en Argentine, le lunfardo, un argot venu de l’italien. Mais mon père avait une langue que personne ne comprenait. De plus, l’espagnol d’Argentine n’est pas l’espagnol d’Espagne. Jamais je ne me suis senti aussi étranger dans ma propre langue que quand j’ai vécu en Espagne. Et je suis incapable de dire si Demain s’annonce plus calme est écrit en français ou en espagnol. Je vis en France et j’ai la chance d’avoir depuis le début le même traducteur, Jean-Marie Saint-Lu. Il a l’habitude de me faire lire une première version de sa traduction, avant de l’envoyer à l’éditeur. Et, en relisant mon roman dans sa version française, j’en ai vu des défauts, et je les ai corrigés. La double distance du temps et de la langue m’a permis de faire mon deuil de ce livre et de le laisser vivre.
1. Ouvroir de littérature potentielle. Groupe créé entre autres par Raymond Queneau et François le Lionnais, qui étudie et pratique la puissance créatrice de la contrainte et des règles formelles.
Le romain de l’homme qui écrivait le romain du fou et du romancier
À partir d’une certaine similitude entre ses parents et le couple Conrad, l’auteur construit un jeu de miroirs où la littérature se fait voir en tous ses reflets.
À Pent Farm, dans le Kent, Jessie et Jozef coulent des jours tranquilles, quand un homme se présente. Il s’appelle Meen, a été marin comme Jozef, et s’est, dit-il, reconnu dans un des personnages de Falk, une de ses nouvelles. Il s’est senti insulté par le portrait qu’a fait de lui l’auteur, il est venu le tuer. Jozef n’est autre que Joseph Conrad, le célèbre écrivain d’origine polonaise. Cette anecdote est le point de départ du roman qu’un écrivain nommé Eduardo Berti veut écrire, presque en tous points similaire à l’auteur du Père étranger, et la raison de son voyage dans le Kent.
Le point de départ, si l’on peut dire, est la découverte par Eduardo Berti de six cahiers d’un roman que son père avait commencé à la fin de sa vie. Et aussi de la similitude de la situation de sa mère et de celle de Jessie Conrad. Toutes les deux ont épousé un étranger, qui avait pris pour nom son deuxième prénom, et originaire d’un pays d’Europe centrale, la Pologne pour l’un, la Roumanie pour l’autre.
Eudardo Berti construit sur cette base une architecture d’une grande subtilité. Le roman sur le père et le roman « du » père, le roman de celui qui a va à Pent Farm pour écrire sur Conrad et le roman qu’il essaie d’écrire se réflètent l’un dans l’autre, et, peu à peu les détails de leurs vies se répondent. Au sein même de chacun des récits, répétitions, symétries abondent. Ainsi, Eduardo Berti se voit attribuer la nationalité roumaine au moment où son père lui annonce son projet d’écriture. « Mon père semblait rivaliser avec moi en écrivant un roman, moi je rivalisais avec lui avec mon titre d’étranger flambant neuf. »
Avec Un père étranger, Eduardo Berti insère dans le deuil de ses parents une histoire foisonnante d’anecdotes mélancoliques et drôles, dont le personnage principal n’est ni le père de l’auteur, ni Conrad, ni son fils, mais le roman lui-même, que l’auteur traque avec une obstination de spirite. « Comme si écrire était pour moi du moins un vaste pays étranger avec sa langue fantôme. »
Article source à lire ici
Florence, pour Les Liseuses de Bordeaux
Le dernier roman d’Eduardo Berti, Un père étranger, vient de paraître aux éditions de la Contre Allée. C’est un récit aux multiples résonnances sur la filiation, l’identité, l’exil, la langue et la fabrique du roman.
Un père étranger est composé de trois récits aux résonnances fortes. Un narrateur se lance dans l’écriture d’un livre sur l’écrivain Josef Conrad et pour cela part dans le Kent, en Angleterre, visiter la maison où celui-ci a résidé. Le second récit est centré sur un lecteur de Conrad, un allemand du nom de Meen, qui croît se reconnaître dans un des personnages d’une nouvelle écrite par Conrad et s’estime humilié par la description que l’auteur en a fait. S’en suit une tentative de tuer l’auteur… Le troisième récit raconte le père d’Eduardo Berti, émigré roumain en Argentine, qui se lance dans l’écriture d’un roman après que son fils ait publié son premier roman, Le désordre éclectique.
Un roman à deux niveaux. Eduardo Berti raconte le roman et la fabrique du roman. « J’ai voulu raconter le making-of du roman. Mon idée était d’alterner le roman et le making-of, mais très vite, les histoires se sont mélangées ». En effet, les trois récits s’imbriquent, s’entremêlent inéluctablement : les ressemblances entre la vie de Josef Conrad et celle du narrateur se reflètent comme dans un miroir et Eduardo Berti, par ailleurs membre de l’Oulipo, n’hésite pas à en jouer à travers la forme de la narration. Il fait dresser au narrateur de son roman des listes d’éléments à intégrer dans le livre qu’il écrit sur Josef Conrad, et expose les quatre dénouements envisagés.
« J’ai essayé de trouver le plus de liberté possible à partir de la forme. Il y a le journal – le carnet de notes – et la possibilité de travailler à partir de plusieurs hypothèses. » On est autant dans le roman que dans le laboratoire du roman.
La langue fantôme. Les personnages d’un père étranger sont tous des exilés, et la langue qu’ils parlent n’est pas leur langue maternelle. Josef Conrad est d’origine polonaise et écrit en anglais, le père du narrateur qui a émigré en Argentine à la fin des années trente pour fuir la montée du nazisme est roumain. Eduardo Berti n’a jamais entendu son père parler roumain, à part une dizaine de mots isolés dont il dresse un inventaire dans le roman, mais raconte qu’il la devinait dans son accent.
« A l’époque, j’aimais bien la notion selon laquelle la « patrie » d’un écrivain est sa langue natale. Aujourd’hui, avec plus d’ancienneté comme étranger, je préfère l’idée que son véritable pays se trouve dans ses livres. »
Josef Conrad et le père d’Eduardo Berti se lancent dans l’écriture d’un roman dans cette autre langue avec, forcément, un rapport assez souple à l’orthographe et à la grammaire. Si l’auteur s’en amuse lorsqu’il lit les six cahiers de son père, Josef Conrad lui bénéficiait de l’appui de son épouse Jessie qui corrigeait ses approximations lorsqu’elle tapait ses manuscrits à la machine. Résonnances.
L’identité. C’est la quatorzième note du fascicule L’identité, publié en parallèle à Un père étranger par les éditions de la Contre Allée, à la fois chapitre fantôme et ouvrage sur la fabrique du roman, qui synthétise le mieux l’interrogation d’Eduardo Berti sur cette question.
« La formidable autorité des passeports et autres documents réside-t-elle en ceci qu’ils établissent doublement l’identité : sur le plan individuel et sur le plan collectif, dans ce qui différencie et dans ce qui unit ? »
Eduardo Berti est allé en Roumanie pour la première fois, après l’écriture d’Un père étranger, et après avoir retrouvé le dossier de naturalisation que son père avait constitué avant sa mort. Pour autant, comme une intuition, il est question de passeport et de la Roumanie dans le roman. Résonnances encore.
L’écriture simple et sobre sert le récit. Avec humour, Eduardo Berti promène le lecteur entre les trois récits fortement imbriqués d’Un père étranger. Et même si l’on ne démêlera jamais le vrai du faux, la biographie de la fiction, on se laisse entraîner dans ce roman très structuré aux multiples questionnements.
Le travail d’Eduardo Berti mérite qu’on s’y intéresse. Aussi, nous vous conseillons un autre de ses romans Le pays imaginé, son recueil de micro-fictions La vie impossible et l’Inventaire d’inventions (inventées).
L’article source est disponible ici

Escale du livre

Maison de la poésie
Captation vidéo de la rencontre du 17 mars à la maison de la poésie de Paris.

par Nikola Delescluse
Aline Sirba pour À voir, à lire
Eduardo Berti signe une « autobiographie oblique » dans laquelle le narrateur argentin (double de l’auteur) écrit un livre sur Joseph Conrad, tandis que son propre père se met à l’écriture peu avant sa mort. Étranger, celui-ci l’est pour plusieurs raisons : ce juif roumain a émigré à Buenos Aires avant la Seconde Guerre mondiale, falsifiant sa date de naissance, abandonnant sa langue natale, son nom et son passé, tout en ayant réussi à préserver ses secrets. Le trio du fils, du père et de Conrad s’inscrit dans une quête d’identité. En effet, la figure de l’écrivain polonais est significative ; l’ancien marin exilé en Grande-Bretagne y a trouvé une patrie et une langue d’écriture. Eduardo Berti se concentre sur la période des récits les plus autobiographiques auxquels Conrad travaille dans sa maison du Kent, tandis qu’un lecteur le persécute, persuadé d’être le double d’un de ses personnages. Installé à Paris, l’écrivain Berti se met en scène dans des péripéties souvent comiques, comme sa visite en Angleterre pour les besoins de son livre, sa rencontre avec de sélectes associations d’amis d’écrivains, son séjour en résidence d’auteur sur une péniche à Béthune, ou encore l’invitation par l’ambassade de Roumanie à recouvrer sa nationalité perdue.
Membre de l’Oulipo, Eduardo Berti recherche la contrainte formelle, goûte les jeux de miroir et les échos, mélange la fiction et l’autobiographie, et déploie son œuvre en cours d’élaboration. Endossant les rôles de lecteur et d’auteur, il réfléchit aux enjeux de la langue dans les notions d’exil et d’altérité, convaincu que la littérature est le creuset de ces questions intimes et universelles.
L’article source est disponible en suivant ce lien.

Une chronique d’Ariane Singer
Michel Lansade, pour Encres Vagabondes
Le narrateur (argentin) emploie la première personne et commence le récit par un portrait de son père, ancien marin roumain exilé à Buenos Aires, après être passé par Paris. Le narrateur s’installe à Paris et décide de rédiger une biographie romancée de Józef (Conrad) d’origine polonaise mais écrivain de langue anglaise, tandis que son père (du narrateur) lui envoie les cahiers de son roman. Il séjourne également ou fait des références au Kent, à Madrid et à Berlin. Tout cela semble compliqué mais la lecture est simple, bien rangée dans des chapitres concentrés sur le père, Cimetière Club 1 et 2 qui ouvrent et closent le récit, commence par l’enterrement de la mère et finit par l’enterrement du père et la révélation finale, Pent Farm 1, 2, 3 et 4 sur la vie de Józef en alternance avec La Déroute 1, 2 et 3 qui forment le roman du père.
Comment se pouvait-il qu’une lecture erronée, une lecture exagérée, pour le moins, exerce une telle influence sur la vie de l’allemand ? Cela n’allait-il peut-être pas plus loin que l’obsession de se chercher et de se trouver dans les livres. De se chercher dans n’importe quel livre pour se trouver dans l’un d’eux, quel qu’il soit. (Je me dis, bien entendu, que c’est ce qui se passe en moi quand je reconnais dans Józef des éléments de mon père : un excès de foi dans les livres, de foi dans la littérature.
Tout cela est fluide car les chapitres bien séparés dans la table des matières sont poreux. Ainsi la biographie de Józef donne l’impression, outre qu’elle est en train de s’écrire sous nos yeux, d’être un peu celle du père et contient une sorte d’autobiographie du narrateur et bien sûr des anecdotes qui parfois ressemblent à des nouvelles (au moins une fait référence à Marcel Aymé) et le roman du père à un roman de Conrad. Le réel entre dans la fiction et l’ensemble des fictions forme un récit sur l’identité du père et le rapport à la langue maternelle qui devient fantôme et la langue étrangère.
… un jour, je m’aperçus que je n’avais plus besoin de me pencher en avant quand on me parlait en français ou quand je m’asseyais devant le téléviseur, non pour regarder de vieux chanteurs de tango, mais des programmes français récents.
À vrai dire, Józef était le premier homme qu’elle entendait parler anglais avec un clair accent étranger. Le premier homme né dans une autre langue et transplanté en anglais. Le premier homme amputé – à demi amputé, préférait-elle – de son étrange langue maternelle : ce polonais pas entièrement évaporé car il survivait dans son accent, dans les gestes dont il ornait son discours et peut être dans la structure de certaines phrases alambiquées.
Je ne téléphonais que très rarement à mon père de Paris. En revanche, je lui écrivais, et je recevais ses réponses écrites dans un espagnol correct, bien que parsemé de fautes. En lisant ses lettres, et en me heurtant à ces fautes, moins de grammaire que d’orthographe, il m’était impossible de ne pas entendre sa voix grave et râpeuse, de ne pas entendre cet accent étranger qui ne semblait jamais lui causer la moindre inhibition.
Mais cela a aussi à voir qu’ayant ouvert le livre au hasard, je lis une citation de Dos Passos en épigraphe : « il est possible d’arracher un homme à son pays ; il est impossible d’arracher son pays du cœur d’un homme. » Je lis ces mots et je me dis que mon père les aurait peut-être désapprouvés.
Eduardo Berti, l’oulipien, nous livre un fabuleux récit, drôle malgré la gravité du propos sur l’exil et la quête de la langue, de la littérature, avec un soupçon de roman policier joyeux.
Pour retrouver l’article d’origine, cliquez ici

par Ariane Singer
Dans un roman tout en jeux de miroirs et récits gigognes, l’écrivain argentin tente de remonter la trace brouillée laissée par son père, né en Roumanie.
Сomment connaître la vie de ses parents quand ceux-ci n’en ont révélé que des bribes ? Dans Un père étranger, l’écrivain argentin Eduardo Berti (né en 1964) part sur les traces de son géniteur, mort une douzaine d’années plus tôt, pour tenter de faire la lumière sur une existence que celui-ci a volontairement brouillée. L’homme, né en Roumanie, s’est réfugié en Argentine et y a épousé une femme plus jeune que lui, la mère de l’auteur, également disparue. Sur ses origines, comme sur son véritable nom, il a emporté nombre de secrets avec lui.
Pour essayer d’en savoir davantage, l’écrivain se plonge dans le roman, inachevé, que ce père avait entrepris d’écrire, dans un espagnol truffé de fautes. Mais ce livre décousu, dont il reproduit quelques extraits, n’est guère plus explicite. Que ra conte vraiment ce récit qui met en scène de pauvres ouvriers roumains, transpor tant du bois par voie fluviale jusqu’à Galatz, ville natale du narrateur? Et que révele le fait que ce dernier vienne d’une famille juive? Là encore, l’énigme persiste.
Est-ce parce qu’il bute sur ce mystere que Berti s’intéresse à une autre figure littéraire? C’est au romancier Joseph Conrad (1857-1924), familièrement rebaptisé «Jozef», que Berti fait appel. Comme son pere, Conrad a connu l’exil par bateau, de Pologne au Royaume-Uni et, comme lui, il a choisi d’écrire dans la langue de son pays d’adoption. Enfin, il a lui aussi changé son nom. Berti décide donc de se rendre dans la ferme du Kent où le romancier polonais s’est installé en 1898 avec sa jeune épouse, Jessie, et leur fils, Borys. Las. Cette aventure faite de péripéties extrêmement drôles s’avérera tout aussi deconcertante.
Monde englouti
Dans ce roman tout en jeux de miroirs et récits gigognes, Berti explore avec un humour tendre la figure de l’étranger, la d’autant plus insaisissable par ses proches qu’il semble avoir fait table rase de son passe en se lovant dans une nouvelle identité. Jessie Conrad est tout aussi intriguée par son mari, épousé en quelques semaines à Londres, que l’est Berti découvrant, adolescent, que son père a falsifié sa date de naissance, entre autres choses. L’épouse de l’un et le fils de l’autre affichent la même perplexité en entendant les deux hommes s’exprimer, à la faveur d’une maladie, dans leur « langue fantôme», qui fait resurgir leur monde englouti.
Berti, exilé volontairement lui aussi, a l’art de faire résonner ces deux histoires avec la sienne. C’est ce qui donne au roman toute sa profondeur. Ayant quitté l’Argentine pour Paris, puis Madrid, il relate ici ses propres difficultes à endosser le costume de l’étranger. Ainsi quand il peine à s’habituer à la froideur des garçons café parisiens ou lorsque, devant donner une conférence en français, il doit faire une pause : son accent, épouvantable ce jour-là, rend ses proproes incompréhensibles. Le romancier n’est jamais plus proche de son père que dans la distance.
Le roman dit aussi la nécessité de se couper parfois de ses racines pour mieux respirer. Dans un long récit enchâssé, Berti retrace l’histoire véridique de cet Allemand, Meen, qui croyant s’être reconnu dans le personnage d’une nouvelle de Conrad, se rendit dans le Kent poru l’assassiner. Une façon tout aussi radicale de tuer le père.
Mélanie, pour la FNAC
Après quatre années de silence et la parution d’Une présence idéale, le romancier argentin Eduardo Berti est de retour avec Un père étranger dans lequel il traite de la question de l’identité et de la transmission, mais aussi d’écriture. Une quête initiatrice et personnelle qui nous fait voyager entre l’Europe et l’Amérique du Sud.
Eduardo Berti : du journalisme à la fiction
Journaliste de formation, l’Argentin Eduardo Berti a d’abord commencé sa carrière d’écrivain par deux essais consacrés à la musique d’Amérique latine, puis par de la traduction d’œuvres européennes, notamment de Jane Austen.
Mais le virus de l’écriture de fiction le prend à la fin des années 1990 et il se fait connaître avec Le désordre électrique, suivi de Madame Wakefield qui concourt pour le prix Fémina. Au rythme d’un roman tous les deux-trois ans, il est devenu l’un des auteurs d’Amérique du Sud les plus incontournables et plébiscités en dehors des frontières de ce continent.
Ses histoires ont pour fil rouge des hommes et femmes du quotidien vivant des événements d’exception, à l’image de cet homme qui explose cinquante ans après avoir reçu des éclats d’obus dans L’inoubliable. Ou de ce boxeur reconverti en horloger dans L’ombre du boxeur ou encore de ces hommes de médecine confrontés à la douleur physique et psychologique de leurs patients dans Une présence idéale.
Un roman hommage à Joseph Conrad
Derrière le romancier, le journaliste n’est jamais bien loin et Eduardo Berti le prouve une nouvelle fois avec Un père étranger. Il nous mène entre Buenos Aires et Madrid, en passant par Paris et l’Angleterre, sur les traces d’un écrivain immigré roumain réécrivant l’histoire de sa famille, à partir des lettres que lui envoie son père. En parallèle, ce dernier écrit également un livre, ce qui désarçonne son fils. D’autant que se rajoute un troisième écrivain, qui ne serait nul autre que Joseph Conrad lui-même… Véritable mise en abyme sur la création et l’écriture, Eduardo Berti traite avec rythme et humour de thématiques plutôt sérieuses, telles que la transmission, l’identité et l’immigration. Une invitation au voyage et au pouvoir de l’imaginaire idéale en ces temps confinés.
L’article source est disponible ici
L’Or des livres
(…) Quête d’identité d’un fils revisitant le parcours mystérieux d’un père au prisme d’un dernier secret découvert seulement après sa mort, Un père étranger interroge la condition d’étranger, notamment du point de vue de la langue : de cette nouvelle gestuelle et même vision du monde incluse dans les sonorités et la syntaxe-même d’une autre langue acquise, comme de cette irrémédiable incommunicabilité et solitude résultant de l’amputation de sa langue d’origine.
En parallèle, le roman aborde également la condition de l’écrivain (et notamment la relation entre langue littéraire d’écriture et «langue fantôme») mais aussi du lecteur, dans une perception fascinante de la littérature, de la fiction, et de son rapport au réel, au passé comme au futur. (…)
Retrouver l’intégralité de l’article d’origine en cliquant ici
La viduité
Récit des dissemblances, des exils et de leurs langues. Sous les allures d’une biographie romancée de Joseph Conrad, Eduardo Berti part à la recherche de ses identités, entre coïncidences et approximatives ressemblances. Confrontation de chaque instant avec l’étrangeté du langage ainsi que ses fantômes, Un père étranger est une belle quête de soi par une confiance rieuse dans la littérature.
Au fond, ce roman brille par son exercice de distanciation, par la possibilité ainsi créer de varier les discours sur un objet qu’il ne prétend jamais tout à fait comprendre. Le récit magnifique de deux échecs, d’une incapacité à finir d’écrire deux livres. Eduardo Berti prétend (la vérité de ce qu’il nous raconte reste heureusement invérifiable, comme suspendue aux nouvelles interprétations que l’auteur pourrait lui inventer) écrire un récit sur Conrad, sa vie domestique. Peu à peu s’impose en lui un personnage qui, faute de s’être reconnu dans une nouvelle, aurait voulu tuer Conrad. Le thème de ce récit devient alors lumineux : de soi qu’est-ce que l’on reconnaît dans un récit ? Ce que l’on y projette est-il seulement notre passé ou ne peut-on pas y deviner, rétrospectivement, une prémonition de notre futur ? Un écart paraît répondre Eduardo Berti. Autant de parenthèses comme mémoire de ce qui aurait pu advenir, expression des versions laissées de côté par l’auteur (pensons ici aux Singes rouges de Philippe Annocque) où niche peut-être ce dans quoi l’auteur pourrait se reconnaître. Une question intéressante est posé : quel souvenir un écrivain garde de ce qu’il a écrit, ses lecteurs n’ont-ils pas une meilleure mémoire de son œuvre ? Vous l’aurez compris Un père étranger est avant tout un livre sur la formation d’un livre. On pourrait penser, en poussant un peu, à une manière d’amalgame entre l’autofiction à la française et le roman délirant, d’une construction baroque tel qu’il se pratique, dans une vulgaire globalisation, en Amérique du Sud, chez Rodrigo Fresan dans son meilleur. Peut-être dans la volonté, propre à tout roman, de donner à voir la présence d’une absence. « Quelque chose comme la synecdoque de l’absence. » Laisser apparaître la vie dans ses amputations plus ou moins volontaires.
(Il m’arrive de penser que je devrais ouvrir au hasard, ou non, un roman de Jozef, traduire en espagnol quelques phrases de l’anglais puis, avec ce « ton », cette langue obtenue dans les marges des pages de Jozef, écrire sur mon père.)
Un père étranger serait l’histoire d’une double identité qui se dédouble. Eduardo Berti, écrivain argentin, à vécu longuement à Paris au point de se sentir comme en exil dans sa propre langue. Ou plutôt de reconnaître cette langue fantôme dans ces lectures, dans ce qu’il tente d’écrire et surtout dans le secret ainsi mis à jour. Conrad, écrivain polonais décide de devenir un styliste anglais. Un père étranger parvient à en faire une curieuse biographie, romancée peut-être mais d’une grande précision. Plongée dans l’intime qui dès lors se dédouble d’une nouvelle part romanesque plutôt drôle : les déboires d’un écrivain chez les gardiens auto-proclamés de l’œuvre du maître. Filouterie et vénalité. L’histoire se dédouble à nouveau pour nous porter vers le double langage de son père. Écrire serait regagner une identité, composite par nécessité et où toujours affleure le secret. Un récit d’exil sans doute même. Le père de l’auteur est roumain, il a abandonné langue et passeport pour s’installer en Argentine. Un père étranger montre alors surtout comment ce que l’on fuit finit par ressurgir. Un accent dans la fatigue ou l’agonie et la langue fantôme ressurgit. Eduardo Berti montre aussi le pouvoir du nom, de l’écriture administrative : écrire sur son père c’est lui retrouver son vrai nom, parvenir alors à s’inventer une identité. L’ultime dédoublement de ce roman foisonnant, remarquablement construit et rythmé, est alors la question de ce que l’on vole de l’autre pour construire un texte. Le caractère autobiographie verse alors dans la fiction, la recomposition – comme pour la vie de Conrad – se fait romanesque. Le père de l’auteur, pour imiter son fils ou pour tenter peut-être de parler la même langue que lui, se lance dans la rédaction d’un roman. Un père étranger nous en livre des extraits qui entrecoupent le récit. On ne peut bien sûr deviner dans quelle mesure ils sont inventés. Tout tombe parfois trop juste pour avoir été inventé. Le titre du roman paternel aurait enchanté Derrida, fait sans doute sourire le membre de L’Oulipo qu’est l’auteur : La dérroute. L’identité roumaine y ressurgit pas seulement par l’orthographe capricieuse. Peut-être davantage dans la volonté d’écrire un roman d’aventure. Notons alors les jolis récits de rêves ou l’identité de l’auteur apparaît et se décompose.
Retrouvez l’article d’origine ici
Christian Roinat, pour America Nostra
Si on part de l’idée que la fonction d’un roman est l’ouverture, Un père étranger en est une brillante preuve. Roumanie, Argentine, Angleterre en sont différents décors à des époques variées. L’ouverture, c’est la découverte (on en saura plus sur Joseph Conrad), c’est la surprise (que fait donc ce personnage à cet endroit et à ce moment ?), le dépaysement (qu’a dû souvent éprouver le personnage central, ou plutôt un des personnages centraux, puis un autre). Portée par un humour subtil et très présent, cette ouverture-là se déguste avec jouissance.
Raconter Un père étranger ? Vous n’y pensez pas, cela tient de la gageure et ce serait parfaitement inutile. Et pourtant il y a une histoire, non, des histoires qui évoluent en parallèle en se croisant, en revenant en arrière pour mieux repartir. On se délecte de ces mouvements sinueux dont chacun est passionnant. Et celui qui raconte ces histoires est un virtuose. Qu’on écoute, bien au chaud dans un pub anglais au siècle dernier les clients intrigués par un inconnu, un Allemand, à ce qu’il paraît, qui aurait informé de son projet de tuer l’écrivain peut-être polonais qui s’est installé dans le coin, qu’on assiste impuissant à la mort du père à Buenos Aires, qu’on envisage avec l’auteur le développement de la même situation en plusieurs scènes possibles, on a l’impression de voler, légers, dans une totale liberté, comme est totale la liberté d’écrire que s’est offerte Eduardo Berti.
Au centre de tout (de ce roman, de notre vie, de la vie), il y a la langue. Oui, mais laquelle ? Celle de l’endroit où nous sommes nés ou celle de l’endroit où nous vivons ? Celle, que nous ne parlons pas, des gens que nous aimons ? Toutes les personnes qui apparaissent dans le roman vivent ailleurs, certaines se sont déplacées au moins une fois dans leur vie, un déplacement définitif (le père), d’autres n’ont cessé de bouger (Joseph Conrad), un autre a mêlé les deux (Eduardo Berti lui-même) : un homme dépend-t-il d’un lieu qu’il habite ou, au contraire, apporte-t-il avec lui quelque chose qui agira sur le lieu ? Ces questions théoriques prennent volume et vie sous la plume d’Eduardo Berti : il tisse à la fois un récit plein de mouvement (normal, avec de tels personnages !) et des liens, évidents ou inattendus (quel rapport entre Le Comte de Monte-Cristo et Madame Bovary ?), d’une solidité à toute épreuve. La solidité dans l’humour : on sourit très souvent, de jeux de mots, de situations à la limite de l’absurde, de surprises (en Angleterre, « même les Polonais doivent rouler à gauche »).
Plusieurs secrets de famille (rien de honteux, genre liaisons inavouables ou enfants cachés), restés dans le silence plus par pudeur ou par négligence, reviennent à la surface, ils ont le double avantage de découvrir l’autre et de se découvrir soi-même (pourquoi n’ai-je pas posé les bonnes questions quand il en était temps ?). Il n’y a pas d’aveux intimes plus pudiques que ceux formulés ici. Eduardo Berti, en parlant de lui et de son père, parle de l’humanité, une humanité qu’on ne peut qu’aimer.
Un père étranger est une de ces lectures enthousiasmantes (la joie des mots !) après laquelle on a l’impression d’avoir gagné en intelligence. Si c’était plus qu’une impression ?
Retrouvez l’article d’origine en cliquant ici
Nouveaux espaces latinos
Les Éditions la Contre Allée viennent de publier « Un père étranger », le dernier ouvrage d’Eduardo Berti, traduit par Jean-Marie Saint-Lu. Avec ce nouveau livre, l’écrivain argentin nous offre un véritable voyage à travers le temps, les continents et l’histoire de sa propre famille.
Roman complexe, qu’on pourrait aborder à partir du concept de translittérature, dans la mesure où il présente une structure dynamique, qui passe d’un genre à un autre : de la biographie à la fiction en passant par l’autobiographie, le matériel documentaire, les notes personnelles ; d’un siècle à un autre : le XIXe, le XXe, le XXI e ; d’un pays à un autre : l’Argentine, la Roumanie, Le Royaume Uni, la France, l’Espagne… Mais aussi roman familial, roman de la littérature, roman d’écrivains et roman de la lecture. Le lien entre tous ces univers est la langue, ou plutôt les langues, leurs accents et leurs défaillances, les langues oubliées ou traduites, les langues adoptées et les langues maternelles, les langues fantômes dont parle le narrateur, et les voix qui les portent.
Nous l’avons dit : c’est un roman complexe, qui agence un dispositif rigoureux de strates composites, et cela avec une telle subtilité et une telle aisance que le lecteur a l’impression de glisser de l’une à l’autre tout naturellement, au rythme scandé des séquences, explorateur ébloui de mondes si divers et néanmoins, par les miracles du montage, si proches. Si au début ces histoires sont racontés de façon différenciée : un chapitre pour chacune, en alternance ; bientôt elles s’entremêlent, interfèrent les unes avec les autres, dialoguent, se rapprochent. Et cela sans que la moindre confusion ne menace, avec une fluidité qui est la preuve –s’il en fallait une- de la maîtrise du métier par Eduardo Berti.
Les histoires s’emboîtent les unes dans les autres, et c’est la réflexion du narrateur –qu’il s’exprime à la première ou à la troisième personne– qui les noue, toujours à la recherche de symptômes, de symétries, de correspondances. Il y a le narrateur autobiographique, Eduardo Berti, argentin, identifié par une multitude de références à son parcours historique vérifiable et à sa vie en Europe qui, ayant le projet d’écrire un roman autour du personnage de Joseph Conrad, entame une sorte de pèlerinage à la recherche de ses traces. Arrivé à Pent Farm, dans le Kent, où l’écrivain polonais a vécu, fiction et biographie se mêlent dans une deuxième histoire, celle de Conrad lui-même.
A cela s’ajoute l’histoire du père du narrateur-auteur, immigré roumain fuyant la guerre et arrivé en Argentine ; et celle, à peine ébauchée, du roman que ce « père étranger » écrit à la fin de sa vie et que le fils ne lira qu’après sa mort. Ce sont tous des personnages déracinés, qui portent le sceau de l’extranéité, qui parlent plus d’une langue, qui sont nés dans l’une d’elles et vivent –et souvent écrivent– dans une autre. Le roumain, le polonais, le castillan, le français, l’anglais se télescopent dans leurs imaginaires, et ils choisissent quand et comment ils se serviront de l’une ou de l’autre comme langue de l’oralité, ou de l’écriture, ou de la mémoire.
Deux écrivains consacrés et un écrivain amateur ; deux d’entre eux optent pour la langue d’adoption et l’autre garde la langue maternelle. Mais tous se sont trouvés confrontés, à un moment ou à un autre, aux mêmes questions, aux mêmes déchirures. Et aussi bien Conrad que le père étranger reviennent involontairement à la langue maternelle lorsque la souffrance guette.
A chaque histoire correspond aussi un roman familial : dans le cadre du récit autobiographique c’est logiquement le regard du fils qui prévaut, et c’est aussi lui qui raconte –reconstruit– l’histoire du père, trouée par tant de silences et d’inconnues. Dans le cas du roman de l’écrivain Conrad, ce regard est plutôt celui de sa femme, qui connaît si peu l’histoire de ce mari toujours insaisissable (« Joseph serait toujours un abîme insondable pour elle »). La distance imposée par les langues –celle de l’origine, qui ne peut pas se partager avec l’autre proche-, par les vies passées qui n’ont pas été racontées, par les silences qui n’ont pas été comblés, laisse place à la conjecture, la spéculation, la fiction, en somme. Non seulement l’on peut parler de langues fantômes, mais aussi de textes et de lectures fantômes.
Et c’est dans ce jeu constant d’une profondeur inouïe : jeu de réverbérations, de reflets, de miroirs inversés, que le roman devient aussi mémoire, méditation généalogique, philosophie des langues et traité de lecture. Dans l’écoulement du temps, tout ne s’en va pas forcément. Il y a des mots, de gestes, des lieux, des histoires qui se répètent, se ressemblent, s’enchaînent, se parlent :
« […] je me rends compte que la lecture du roman de mon père occupe, semaine après semaine, jour après jour, une place plus importante que l’écriture de mon propre roman ; je me rends compte que l’auteur d’un roman sur un père étranger est devenu, avant tout, un lecteur d’un roman écrit par son père étranger, au point qu’il en rêve au lieu de rêver du livre qu’il s’obstine à écrire. » D’ailleurs, entre-temps il est devenu, à son tour, un père étranger.
Au bout du voyage, Eduardo Berti sait qu’il peut, en toute légitimité et avec beaucoup d’humour, se permettre de circuler dans ce flux de diversités parce que, en dernière instance, le passé –ce qui n’as pas été dit–, les vies des autres –ceux qu’on cherche en vain à connaître–, les langues –celles qu’on délaisse et celles qu’on cultive– sont, finalement, des inconnues à déchiffrer ; « comme si au fond l’écriture était, pour moi du moins, un vaste pays étranger avec sa vaste langue fantôme ».
Marián SEMILLA DURÁN

Libération
Un père étranger est une histoire de fantôme qui n’a rien de surnaturel. C’est un récit autobiographique dont Joseph Conrad est cependant plus ou moins le héros sans que son nom apparaisse jamais. C’est une aventure de secrets rechignant à perdre leur nature secrète, qui commence dans un «cimetière de merde» avec l’enterrement d’une mère et s’y achève alors que le père lui aussi est mort.
Eduardo Berti est né en 1964 en Argentine et a vécu un temps avec sa femme dans le quartier Denfert-Rochereau, à Paris, permettant «la plaisanterie rimbaldienne d’une saison à Denfert». Son père était un Roumain qui refit sa vie en Argentine et le fils ne saisit pas un mot de cette langue, comme Jessie ne comprenait pas un mot de polonais même quand elle fut mariée avec Józef. Józef, c’est Joseph Conrad, Jessie est sa femme et la part principale d’Un père étranger se déroule géographiquement autour de Pent Farm, la maison anglaise où vécut le couple (et son fils Borys). Eduardo Berti souhaiterait y passer une nuit, car il veut écrire à ce sujet sans encore y parvenir. Il veut aussi écrire à propos de son père qui à la fin de sa vie a écrit lui-même (en un espagnol fautif). Il veut écrire il ne sait plus bien quoi, les éléments se mêlent. De même que les amputés sentent leur «membre fantôme», «Jessie pensait que Józef possédait une langue fantôme», comme le père d’Eduardo Berti et peut-être Eduardo Berti lui-même, puisque «écrire était, pour moi du moins, un vaste pays étranger avec sa vaste langue fantôme». De quoi sont amputés les exilés linguistiques, de quelle réalité fantôme ? Un père étranger est une sorte d’enquête identitaire excédant aux deux sens du terme les cadres littéraire et familial.
En 1903, Joseph Conrad a publié un recueil de quatre nouvelles, Typhon, Pour demain, Falk et Amy Foster. Les deux dernières ont ici un rôle concret dans l’intrigue. La première parce qu’un personnage s’y étant reconnu veut tuer son auteur («les possessifs ne sont pas clairs lorsqu’il s’agit de parler de livres», s’agit-il du livre écrit par Conrad ou de celui que possède un de ses lecteurs, n’y a-t-il pas toujours le risque d’«un excès de foi dans les livres, de foi dans la littérature» ?). Amy Foster parce qu’elle parle de Joseph Conrad qui gémissait des sons incompréhensibles pour ses proches lors de ses crises de goutte et aussi du père d’Eduardo Berti, puisqu’il s’agit en quelque sorte de quelqu’un qui meurt dans une langue étrangère. En fait, les éléments les plus étranges de ce qu’on peut appeler langages s’expriment tout au long du roman. C’est au début le père expliquant au fils qu’il n’aurait jamais pensé survivre à la mère «avec une espèce de nœud dans la gorge qui s’était révélé contagieux». Plus de 200 pages plus loin, c’est le fils de Józef et Jessie faisant face au soi-disant tueur mû par Falk armé d’une carabine. «Borys sentit que le cri qu’il avait décidé de réprimer était toujours étranglé dans sa gorge.» Quant à Eduardo Berti qui repousse la lecture du manuscrit de son père dont le titre même – «la Derroute» – est une erreur disant une vérité, il se trouve avec «deux livres à terminer (l’un comme écrivain, l’autre comme lecteur)».
Eduardo Berti est depuis 2014 membre de l’Oulipo, l’Ouvroir de littérature potentielle où on se livre à des jeux et des expérimentations langagières (Raymond Queneau et Georges Perec en furent). Quand il compare son exil à celui de son père il sait que ce n’est «qu’un jeu ou une expérience» : «mais je savais également qu’il ne faut jamais dédaigner l’importance des jeux et des expériences». C’est par jeu que Joseph Conrad devient en quelque sorte un membre de la famille, mais c’est une expérience, mais c’est une identité. Il se révèle que le père d’Eduardo Berti, comme Józef Teodor Konrad Korzeniowski, a changé de nom, et «ce changement de nom avait été une sorte de chirurgie esthétique, une façon d’effacer le passé et de se réinventer».
Il y a beaucoup d’humour dans Un père étranger, l’auteur s’en prenant aux mécènes plus friands de «flatteries que des œuvres qu’on écrit et publie grâce à eux», et cite ce prologue de Conrad à un livre de cuisine de Jessie selon lequel, «de tous les livres produits depuis des temps anciens, seuls les livres de cuisine sont, d’un point de vue moral, au-dessus de tout soupçon». Au fond de lui, Eduardo Berti a bien «un petit interstice pour les émotions fortes» mais pas de quoi être impudique, «parce que la pudeur, Józef le répétait souvent à Hueffer [plus connu comme Ford Madox Ford, ndlr], était le dernier refuge de l’écrivain : rien de plus humiliant ou de plus triste qu’une émotion qui n’émeut pas».
L’article d’origine est disponible ici

Le matricule des anges
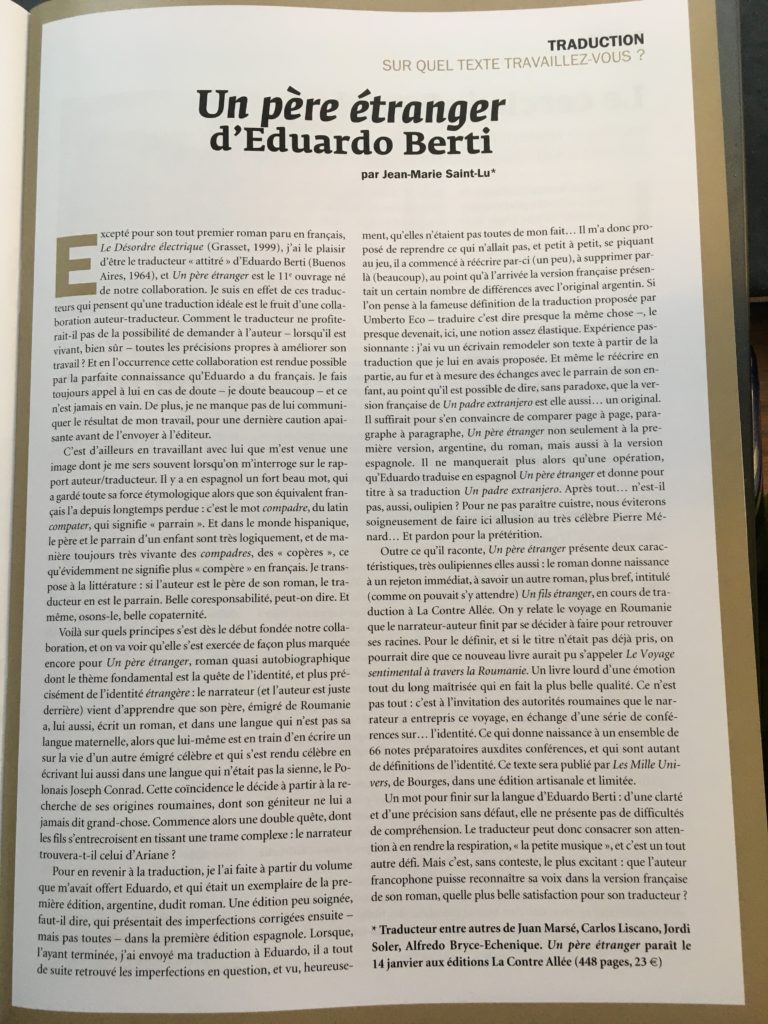
Anastasia, pour la FNAC
Fils d’un immigré roumain qui s’installa à Buenos Aires, le narrateur déménage à Paris. C’est dans un café de la capitale qu’il installe une routine : celle de lire les lettres que son père lui envoie, permettant la réminiscence de l’histoire familiale. Mais si le fils est écrivain, le père est également en train d’écrire un livre.
À cette histoire se mêle aussi celle de Josef et son épouse Jessie, installés en Angleterre et tous deux d’origine polonaise.
Dans Un père étranger, Eduardo Berti fait s’imbriquer les différents personnages, créant une résonance et posant des questions fondamentales comme celle de l’identité, l’exil, la transmission et l’écriture.
Retrouvez l’article complet ici

