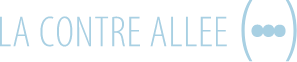En attendant Nadeau par Gabrielle Napoli
D’Antoine Mouton, on se souvient de Chômage monstre (La Contre Allée, 2017), qui questionnait la manière dont le travail occupe nos vies, sur le plan intime et collectif. Dans un texte étonnant et stimulant, Nom d’un animal, en partie écrit dans le cadre d’une collaboration avec la compagnie théâtrale Jeanne Simone, l’écrivain interroge de nouveau le mot « travail ». Sa langue prend corps au fil des pages, une langue étonnante qui virevolte et grince, faisant danser ensemble le rire et la gravité.
En intégrant dans Nom d’un animal les paroles des uns et des autres, l’auteur s’en prend à nos représentations, avec beaucoup de fantaisie et une certaine gaieté. C’est à partir de cette mise en commun des langages que nous pouvons questionner au mieux la manière dont nous avons, dans notre rapport au travail, un lien qui relève d’une expérience singulière, parfois presque secrète, mais aussi une relation empreinte de tout ce qui fonde la façon dont une société envisage le travail. Et c’est à cette mise en commun passée au tamis de l’écriture d’Antoine Mouton et de son esprit délicieusement critique que nous accédons en lisant Nom d’un animal, ce qui fait de cette lecture un moment de pur plaisir. Page après page, la finesse d’Antoine Mouton nous fait du bien, et lorsqu’il écrit : « Un jour j’aimerais écrire un texte qui rendrait la parole à quelqu’un qui l’aurait perdue », c’est exactement ce à quoi il parvient, en restituant à chacun d’entre nous une parole que nous négligeons souvent, celle de la sagacité tendre.
Le travail habite les corps et les âmes, et le langage qui est censé critiquer le travail semble envahir tout autant l’intimité des êtres, ce qui rend sa dénonciation ardue, et la déconstruction des stéréotypes indispensable, travail de sape qu’Antoine Mouton mène avec drôlerie et sérieux. Par exemple, plusieurs pages sont consacrées au burn-out, et à la manière dont l’expression, d’après l’auteur, prive ceux qui le vivent de toute parole, à la manière dont l’identification du burn-out achève la dépossession, ce mot qui s’est « infiltré » dans la langue : « Dire qu’on a fait un burn-out mais pas qu’on a envie de se pendre de temps en temps. Dire qu’on a fait un burn-out à cause des méthodes de harcèlement dans l’entreprise pour laquelle on travaille, mais taire le fait qu’on est harcelés depuis l’enfance par un père ou une mère qui nous ont préparés à endurer le maximum de violence. Attaquer la société mais protéger encore et toujours la famille, comme si c’était différent. » Et pourtant, la dénonciation de ce noyautage est elle aussi une manière de déposséder ceux qui vivent l’expérience de cette souffrance, lorsqu’elle conduit à adopter un point de vue surplombant qui est précisément ce que refusent l’écriture d’Antoine Mouton et tout le livre dans la manière dont il est pensé.
Pour lire l’article au complet :
https://www.en-attendant-nadeau.fr/2025/06/26/poesie-au-travail-nom-dun-animal