Revue de presse
← Sortir de chez soi
Cultures plurielles
Après avoir refermé le livre de Luba Jurgenson, Sortir de chez soi publié aux éditions La Contre Allée, le mystère de la traduction est toujours aussi entier pour le néophyte. Mais entre le début de notre lecture et sa fin, nous avons cheminé aux côtés d’une truchement, littéralement d’une intermédiaire, et nous voilà un peu transformé-e-s par cette flânerie.
Chemin faisant, Luba Jurgenson a semé des petites pierres au fond de nous qu’elle a ostensiblement ignorées par la suite, pour nous égarer à nouveau et pour défaire des sens évidents tout en suggérant de nouvelles résonances. Nous sommes-nous perdu-e-s pour autant ? Ce n’est pas sûr et si dans les dernières pages de cette promenade littéraire au pays des passe-murailles, l’auteur apostrophe le loup qui se cache dans »les bois de l’incompréhensible. » c’est pour mieux se/nous découvrir : »Le loup, c’est moi. »

Mann im Wald (Homme dans la forêt), Anselm Kiefer, 1971, collection particulière)
Quand traduire c’est se traquer dans les interstices d’une langue tue
Dans le fond, tout lecteur habité par plusieurs langues, comme les Algérien-ne-s notamment, éprouvent ce sentiment quelque fois dans leur fabuleuse polyglossie entre le berbère, l’arabe dialectal et l’arabe classique, sans parler des quelques vestiges de français. La hiérarchisation des langues induit la nostalgie d’une langue maternelle, »adamique » nous dit Jurgenson, première vectrice des profondes émotions de l’enfance et gardienne des fantômes. Quand une des langues, à l’image de l’allemand ou du russe pour l’auteur, ou du français pour les Algérien-ne-s, cèle dans son intériorité une négativité troublante fruit des événements historiques, le rapport à celle-ci s’épaissit et devient ambivalent.
Assia Djebar y consacre ainsi de magnifiques pages dans ses essais (cf mon article sur la réponse au discours d’Andreï Makine à l’Académie française) tout comme Malek Alloula (ici mon hommage au poète), qui évoque, quant à lui, l’autre langue, la »langue fantôme » pour désigner l’arabe dialectal oranais qui travaille son français. Jurgenson parle d’un »travail en sourdine » ( »La langue russe travaille en sourdine mon français ») : »c’est elle ma langue fantôme, déclare Alloula dans un entretien avec Yamna Abdelkader-Chaldi, celle qui me hante, me parcourt, tel un spectre familier une vieille bâtisse non désaffectée. J’en suis habité sans jouir d’aucun confort. » Enfin, parmi la nouvelle génération d’auteurs algériens, les Lynda Chouiten (ici mon article sur Une Valse et Des Rêves à leur portée), Salah Badis ou Samir Kacimi entre autres, les emprunts et citations à la derja et au berbère ne se réduisent pas à une simple fioriture stylistique ou à une expression nostalgique mais fécondent une langue profondément irriguée et pensée à l’aune de cette cohabitation langagière.
À la recherche d’une langue absente
Mais pour revenir à l’essai de Jurgenson, qui nous révèle tant de notre relation à notre langue rêvée ou déconstruite, la traversée des langues ne mène ni à la source ni à la cible, elle se donne tout entière dans le chemin, dans le »traduire » comme le précise l’autrice. Au travers de la traduction, qui s’apparente joliment à une pollinisation sous sa plume, le lecteur pérégrine sur un sentier qui s’ouvre telle la grotte d’Ali-Baba. Mais en lieu et place des trésors des voleurs, s’agitent dans un brouhaha pré-babélien des »mots fantômes ». Que désignent-ils ? Et pourquoi surgissent-ils ainsi, à l’orée du bois ?

Buchenwald 1, Forêt de hêtres, Klimt, 1902, Collections nationales de Dresde
Le lecteur le pressent, au cours de sa lecture-excursion, ce qui se noue, ce qui se balbutie dans l’interstice des langues, sous la menace des malentendus, des contre-sens et autres russismes ou anglicismes, c’est la trace des absents et des absentes. Ces lettres, voyelles E chez Perec, voyelle slave perdue entre le I et le U chez Biély, traduite en E, c’est le O du fleuve Don que le poème de Marina Tsvetaïeva transforme en tombeau des soldats blancs de 18, ce sont ces voyelles donc »transparentes comme du verre qui se brisent en traduction. » Dans cette remontée des antres des langues, un peu comme aux enfers, la tentation est grande de se retourner pour les épingler, tel l’entomologiste et ses ailes de papillons, or ces voyelles, dépositaires de la présence de tous les absents, de ceux sans qui les langues ne se transformeraient pas en phrase, en poème, en style, en vers, ces voyelles se dissiperaient et »le traduire » ne pourrait traquer leur insaisissable musique chère à Verlaine et aux autres.
De la langue aux langues
La réflexion se déroule au fil des mots et penser la traduction offre une vue inouïe sur le paysage d’une langue. Belvédère certes mais dont l’angle de vue, ample et général, repose sur une intime connaissance de chaque mot du paysage. Microcosme dans le macrocosme, à l’image des reflets, miroir, bulles et autres surfaces qui réverbèrent dans les tableaux flamands. Luba Jurgenson relève le rideau qui couvre le miroir et découvre les coulisses de l’atelier du traducteur. On pénètre dans une langue par la petite porte, nous souffle l’auteur, par ses prépositions et autres conjonctions qui rendent les infimes nuances de la langue. On s’y promène comme à travers »des forêts de symboles » et on y apprend que le CH est blanc sur sa palette acoustique.
Sortir de chez soi et marcher pour faire résonner les mots et suturer les langues, leurs univers qui ne tiennent qu’à quelques lettres, leurs agencements, leurs tintements. Ces rêveries dessinent les contours d’un vertigineux entre-deux, un »presque », un quasi qui ne recouvre jamais parfaitement le mot, à moins d’un miracle de la traduction comme Luba Jurgenson aime à les baptiser, des miracles qui doublent encore l’épaisseur de la vêture des mots – ainsi de cette parfaite concordance entre l’ombre, le poisson dans le texte de Sergueï Lebedev La Limite de l’oubli, qui dévore les ombres-victimes des terreurs staliniennes. Et se glissent dans l’interstice du »pas-tout-à-fait-traduisible » toute la palette des doutes et des méditations du truchement.

Les Contemplatifs de Abdallah Benanteur, 1988, Musée de l’Institut du monde arabe
Car Sortir de chez soi ouvre la procession bruissante des langues, de leur syntaxe, des coulisses, de leurs musicalité. À chaque station, les mots éprouvent dans leur chair et leur matérialité les aventures du mot traduire. Cette traversée du vide se déroule avec pour compagnes et compagnons les innombrables textes qui jonchent les langues de leurs restes. Un palimpseste-humus qui regorge de possibles. Et on assiste, émerveillé, aux multiples naissances de la traduction d’un poème de Khodassevitch dont les vers, d’une efficacité redoutable dans leur chute, recèlent tous les suicidés-sacrifiés qui déambulèrent dans les rues de Berlin ou de Paris dans ces années-là. Tout comme Luba Jurgenson nous dévoile son exact envers, le poème d’Akhmatova, Un poème sans héros, traduit d’une traite, et aussitôt perdu, sorte d’horizon indépassable, »prototraduction » à jamais vouée à n’être qu’une trace.
Une marche qui ouvre ses horizons

Méditerranéens, Abdallah Benanteur, 1992, musée de l’Institut du monde arabe
Sortir de chez soi pour se lancer dans une lente exploration du monde que l’on croit hors de soi mais qui au terme du voyage pend juste là au bout de sa langue, de ses langues, nourri par les rencontres du chemin. Cette sortie, quasi une expulsion comme le nouveau-né, enfante une révolution, un renversement de vue, celle d’une silhouette toujours en marche vers les possibles inépuisables d’un texte, une marche qui ouvre ses horizons. C’est la traduction, ou du moins, d’une des innombrables définitions que Luba Jurgenson tisse délicatement autour des mots, des langues et des morts pour circonscrire son activité.
J’ai déjà clamé mon amour et ma reconnaissance aux traducteurs-trices sans qui des textes si lointains et pourtant déjà enracinés en nous ne germineraient pas à notre surface. Sortir de chez soi m’offre l’occasion de me répéter.
Amel Boudali.
France Culture : Sortir de chez soi, de Luba Jurgenson
Luba Jurgenson se dit toujours marquée par ce qu’elle désigne comme une étrangeté propre à son parcours et a prioi contre-intuitive pour un travail de traduction : au lieu de ramener une culture étrangère vers sa langue maternelle — le russe — elle a traduit vers sa langue d’adoption, le français. Dans Sortir de chez soi, qui n’est pas à proprement parler un ouvrage de poésie, Luba Jurgenson démine cet a priori et s’interroge sur ce qu’est un « à proprement parler. »
L’avis de nos critiques :
- Anne Dujin trouve formidable que l’auteure restitue un rapport à la langue « comme expérience physique« , d’abord éprouvée dans l’enfance et dans ce moment où “nommer, c’est faire surgir le réel.” On passe ainsi de son expérience d’enfant et d’écolière qui apprend le français à son expérience de traductrice.
- Romain de Becdelièvre souligne que, par ce texte, “on entre dans la fabrique du poème et du sens.” Ici, traduire, c’est toujours sortir de chez soi plutôt que d’aller vers l’intime. Un mouvement vers l’extérieur et un renversement que l’on retrouve tout au long du recueil.

Thomas Stélandre, pour Libération
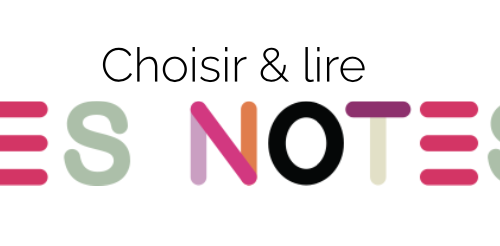
Choisir & Lire : Les notes
Isabelle Baladine Howald, pour Poesibao

Podcast de la rencontre de Corinna Gepner et Luba Jurgenson, Remue.net
Corinna Gepner, actuellement en résidence à L’Arbre du voyageur, a reçu le 13 avril 2023, l’autrice et traductrice Luba Jurgenson pour ses deux nouveaux livres Sortir de chez soi (La Contre Allée) et Quand nous nous sommes réveillés (Verdier). L’occasion de parler avec elle de langue, de traduction. D’engagement aussi, et des multiples échos et résonances qui dialoguent dans l’histoire.
Retrouvez ici l’enregistrement de cette rencontre !


